
Licorice Pizza
J’aime me laisser surprendre par les revers de Paul Thomas Anderson. Quand je pourrais m’attendre à un coup franc ou un coup droit, subrepticement le geste m’enveloppe et fait un détour pour mieux intercepter mes émotions au prochain carrefour.
C’est du moins ce que j’avais ressenti devant Phantom Thread ; ce qui me bouleverse aujourd’hui devant Licorice Pizza – littéralement pizza à la réglisse, une image sucrée-salée à la fois douce et audacieuse, réversible, chargée d’antinomie et de malice.
Gary et Alana : un garçon aussi entrepreneur qu’entreprenant, une adulescente à la trajectoire peu cernée.
Il la courtise et l’invite à dîner, elle le rabroue et le traite de lourdaud. Pourtant elle sera là dès le premier soir ; elle arrivera l’air de rien au bar, sur son visage un mélange d’aplomb et d’appréhension, feignant d’ignorer sa compagnie.
Le mouvement est la condition sine qua non de leur rencontre embarquée, comme s’ils n’étaient autorisés à se parler que dans l’espace transitoire d’une allée ou dans la contiguïté conviviale des espaces partagés – attablés face à face, en voiture côte à côte.
Ils n’anticipent pas la douceur de leurs propres émois et s’annoncent la plupart du temps revêches dans leurs réparties, indomptés ou rigolards…
En certains instants la musique seventies s’arrête et crée un temps suspendu, laissant place au doute qui traverse leurs regards interrogateurs. Comme ce soir où, jaloux, Gary compose le numéro d’Alana dans l’idée de se faire passer pour son petit ami. Sans parvenir à piper mot, il raccroche ; mais démasqué, elle le rappelle. La compréhension sensible d’un jeu tacite très sérieux s’installe entre les deux soupirants. Ils triturent le cordon spiralé du téléphone mais s’interdisent de laisser entendre leur voix ou leur respiration. Le temps s’épaissit, les combinés se reposent avec la précision d’une bombe à retardement. Les révélations muettes se confessent : l’amour doit attendre.
Le cinéaste crée un immense travelling latéral de l’Amérique des années 70-80, circonscrivant les rues californiennes, entre crise pétrolière et campagnes électorales. Il fait état d’un certain âge d’or où l’on pouvait (semble-t-il), à l’aube de ses 15 ans et en un claquement de doigts, ouvrir un magasin de matelas à eaux ou une salle de flipper.
C’est dans ce contexte qu’Alana et Gary se lient d’un amour progressif et silencieux. Le film est en marche constante et leur emboîte le pas, les associés-amoureux toujours à bord d’un véhicule ou ne cessant de courir l’un vers l’autre, accélérant parfois soudainement le cours du temps et de l’histoire – comme un coup sur la pédale de l’accélérateur, Alana au volant le plus souvent (se retrouver passagère ne lui réussit guère, en atteste la fois où elle décolle de l’arrière d’une moto).
Et tandis qu’on croirait être embarqué dans une romance, Paul Thomas Anderson bifurque et nous fait monter à bord d’un camion pour livrer un waterbed au compagnon de Barbra Streisand. Cette longue séquence agit au cœur du film comme une intrigue autonome avec son propre climax. Le silence prend de nouveau le relai sur la musique pour mieux mesurer toute l’amplitude émotionnelle de la scène ; ici lorsque le poids lourd – piloté par Alana (comme de juste) – se retrouve à court d’essence et menace de dévaler une pente en marche arrière. Le suspense est à son comble, et pour cause, le client qu’ils viennent de livrer peut surgir à tout moment leur casser la figure. Ce personnage – un Bradley Cooper fou à moitié ivre de gasoline –, tout comme celui incarné par Sean Penn plus tôt (ivre tout court), prendra quelques minutes les rênes du film et mimera de vouloir crever l’écran. Mais les mascarades divertissantes jouent comme des leurres dans l’histoire d’Alana et Gary, pour à chaque fois mieux les rallier à une cause commune. La vedette ne leur est jamais volée bien longtemps, les mastodontes se désérigeant d’eux-mêmes, emportés par l’extravagance de leur mégalomanie.
Le film se compose de micro-aventures qui petit à petit construisent un temps palpable, un quotidien que partage le duo complice, et qui nous lient à eux à mesure qu’ils créent leurs propres liens indéfectibles.
Les temporalités sont prégnantes mais diffuses, on ne sait pas tout à fait combien de mois, d’années passent. Les personnages ont le même âge de bout en bout mais semblent traverser plusieurs vies. Cette sensation est en partie liée à la fougue qui caractérise leurs différentes tentatives d’entreprenariat, et leur fureur de vivre qui transcende la question des âges.
L’histoire sentimentale s’ancre avec la discrétion de ses empreintes narratives, délivrant le cinéma d’une obligation de démonstration pas toujours vraisemblable. Car quand bien même une rencontre amoureuse peut s’avérer singulière par ses fulgurantes immédiatetés, une relation est peut-être avant tout la somme d’événements périphériques qui façonne un temps de vie commun. C’est ce qu’offre Paul Thomas Anderson à ses personnages : de la matière « temps », des durées pour modeler leurs sentiments.
Et dans une familière cartographie des lieux, les deux jeunes acolytes empruntent des chemins de traverse, s’éloignent et se croisent, se retrouvent, dans une sorte d’évidence mutique qui les désarme toujours, avec de gros plans sur leurs sourires qui laissent découvrir des quenottes insolites et obsédantes.
Janvier 2022

Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson, 2021
À l’abordage
Paris, une rencontre amoureuse un soir d’été. Alma doit précipitamment quitter Félix au petit matin pour prendre un train. La brièveté corroborant la fougue, Félix convainc son ami Chérif d’embarquer avec lui à bord d’un covoiturage pour rejoindre la jeune femme.
Ce qui frappe d’emblée, c’est peut-être ce départ de la capitale, et le changement de décors. Le film ne démarre pas dans la Drôme, il nous emmène dans la Drôme. Du motif urbain au motif pastoral, la connotation du trajet est singulière ; bien que bref, il s’incorpore à une réalité géographique et insinue les vacances, introduit l’idée du voyage et de la distance. Ce trajet est d’autant moins anecdotique qu’il a une forte valeur symbolique dans la conquête amoureuse – traverser la France pour vivre l’hypothétique « après » d’une rencontre, ce n’est pas rien. Tout est à la fois très ancré et précipité, impulsé par l’éclosion du désir.
L’arrivée dans cette région du sud me procure la même surprise qu’à Félix, lorsqu’il découvre avec un certain émerveillement la rivière en contrebas de la route. L’épopée automobile rend physiquement perceptibles les changements d’atmosphères, et permet d’envisager chacun des lieux comme autant de zones nouvelles à explorer. La vie et la nature prennent le pas sur le décor du film, valeureuses.
C’est ainsi que Félix et Chérif apprivoisent un milieu qui n’est pas le leur. Et le regard qu’ils posent sur leur environnement est traduit avec beaucoup de justesse par une mise en scène attentive à ce qui peut surgir de la liberté des dialogues.
Guillaume Brac filme avec une sincère curiosité les paysages, les gens, dans une sorte de naturalisme qui outrepasse la fiction. En cela le cinéaste reste solidement attelé au documentaire, l’identité des lieux et celle des comédiens s’imprégnant mutuellement de leurs sèves respectives. L’Île au trésor n’est pas loin, les jeunes s’amusent dans la rivière comme d’autres s’amusaient sur l’île de loisirs de Cergy-Pontoise. L’été s’exauce avec certitude. De la même façon, lorsque Félix concurrence Édouard dans une épreuve physique, à vélo sur les routes vallonnées, je pense au Repos des braves, dans lequel Brac filmait déjà avec beaucoup d’humour et d’empathie les coureurs cyclistes.
On ressent l’attention et l’attachement réels que porte le cinéaste au bitume chaud, aux végétations gorgées de soleil, le regard délicat qu’il pose sur les piscines et les buvettes des campings ; et jusque dans un pied qui trébuche sur la corde d’une tente, derrière la moquerie se loge toujours une bienveillance soucieuse de laisser sa chance à qui veut bien porter un regard neuf sur ce qui l’entoure...
La vie déborde du cadre donc, mais le cadre existe ! Et maintenant fermement les rênes de sa trame fictionnelle, Brac opère de savoureux glissements scénaristiques ; sans créer de rupture mais plutôt en favorisant une circulation continue des corps et des émotions, à travers le temps et les espaces, dans une volonté d’apprivoiser et d’unir les inconnu(e)s d’une grande équation. Ce tant à l’échelle individuelle – comme on assemble les maillons de sa propre histoire – qu’à une échelle plus sociétale – comme on s’extrait momentanément de la foule pour placer son regard au-dessus d’une carte géographique.
Prendre de la hauteur sur nos vies en mouvement, redéfinir les axes du trafic.
C’est le pari gagné d’un cinéma qui se construit au fil des vécus, à l’écoute de son temps, du murmure des lieux et des gens qui les habitent, les révèlent, les transforment.
Juin 2021
![]() À l’abordage, Guillaume Brac, 2021
À l’abordage, Guillaume Brac, 2021
 À l’abordage, Guillaume Brac, 2021
À l’abordage, Guillaume Brac, 2021Conversation secrète
Lente descente en plongée dans un bain de foule, la caméra est aimantée par un mime qui s’agite au milieu des passants. À mesure que le cadre se resserre, notre attention se décentre sur un homme vêtu d’un imperméable ; le mime emprunte ses gestes tandis qu’il porte un gobelet à ses lèvres. On ne le sait pas encore mais cet homme ne souhaite pourtant pas être remarqué, il essayait même jusqu’ici de se fondre dans le décor.
Harry Caul est ce qu’on appelle dans le milieu un « plombier ». Il espionne des gens pour le compte de tiers, avec un arsenal de micros très sophistiqués et des acolytes qui font antenne en plusieurs points stratégiques autour de sa cible. Aujourd’hui, il est en charge d’enregistrer la conversation d’un couple qui se balade sur Union Square.
Gene Hackman incarne un homme à l’image de son imperméable, taciturne mais pas complètement opaque, qui laisse filtrer la lumière à travers l’épaisseur translucide et grisâtre de sa matière. Une fêlure, une brèche. Harry Caul, à l’écoute de l’enregistrement d’Union Square décèle dans la voix féminine capturée une émotion qui le perturbe, et de fil en aiguille échafaude l’idée d’un danger qui planerait autour de cette femme. L’ombre d’un meurtre en préparation ? Non sans rappeler le film d’Antonioni, notre espion s’attèle ici à décrypter les mots d’un couple adultère plutôt qu’une photographie. À mesure que leurs pas les portent à renouveler la boucle de leur promenade – ils tournent en rond –, ce couple se laisse pénétrer d’une inquiétude perceptible mais difficile à sonder. Ne font-ils « rien de mal » ? Eux-mêmes se questionnent, et leurs paroles équivoques suppurent de tout leur soûl sur les propres peurs de Caul.
Supra-conscient de la quasi-impossibilité de protéger le secret d’une parole émise, et par là même ce qu’un être humain ressent et divulgue, Harry Caul s’inflige une espèce de mutisme austère et mystérieux. Il ne dévoile rien de sa personne à la femme qu’il aime, appliquant probablement sur lui-même un principe de précaution qui manquerait aux victimes de ses talents. Si cette attitude au premier abord peut sembler plus névrotique que vitalisante, il est intéressant de transposer cette question de l’espionnage à notre société actuelle. Car si les peurs de Caul paraissent quelque peu excessives, ne réside-t-il pas à l’inverse dans le quotidien digital d’aujourd’hui, dans notre soif d’images et de paroles, une sorte d’addiction mêlée de résignation face à l’exposition et l’exploitation de nos données individuelles ? Nous nous constituons pourtant un peu plus chaque jour, par le biais de multiples supports, les victimes volontaires d’un exercice d’extinction du droit à l’intimité. Et à cet égard Harry Caul, par sa peur d’être infiltré, torpillé et mis à nu, représente un anti-héros valeureux presque enviable.
Envier l’âme malade d’un personnage seul et malheureux en dit long sur l’état d’une société, sur la misère intime dans laquelle tout un chacun erre et œuvre, à travers les outils numériques qui font des êtres humains les produits-prisonniers d’une surveillance globale.
– Si tu étais une femme qui attendait quelqu’un… Si tu ne pouvais pas savoir quand il viendrait te voir, et que tu vivais toute seule, et que tu ignorais tout de lui… Et si tu l’aimais et avais été patiente avec lui, et ce même s’il n’avait jamais osé te dire quoi que ce soit de personnel sur lui, même s’il t’avait aimée… Est-ce que tu reviendrais vers lui ?
– Comment saurais-je qu’il m’aime ?
– Tu ne pourrais pas le savoir.
Le revers de médaille d’un secret bien gardé, c’est qu’à trop compter sur les capacités d’autrui pour lire entre les lignes, on en néglige peut-être l’importance de partager certaines des vérités les plus constitutives d’une relation. Comment être certain qu’un amour existe si celui-ci n’est jamais nommé ? À quelle altérité se raccrocher quand le miroir ne reflète plus que la solitude d’un sentiment suspendu, égaré ?
Entre paranoïa et intuition féconde, la mise en scène de Coppola se calque sur les perceptions de Caul et nous perd habilement entre l’hypothèse et sa vérification.
Chercher du sens dans l’anodin et dans les silences, dans le souffle ou le timbre d’une voix ; une poésie de l’observation par la répétition d’une parole, le ressassement d’un borborygme, une bande sonore qu’on rembobine et dont on affine toujours plus le mixage – la juste pression d’un pouce et d’un index autour d’une molette. Comme la lumière éclaire soudainement un recoin sombre : rendre audible une parole, la révéler au pinacle, cristalline.
Mars 2021
![]() Conversation secrète, Francis Ford Coppola, 1974
Conversation secrète, Francis Ford Coppola, 1974
 Conversation secrète, Francis Ford Coppola, 1974
Conversation secrète, Francis Ford Coppola, 1974L’une chante, l’autre pas
À la question de Jérôme « vous m’attendiez ? », sans tergiversation ni provocation Pauline répond un « non » assumé. Ce premier échange de paroles est à l’image du film : drôle, incisif et franc. Les femmes ici n’attendent pas les hommes. Pauline a 17 ans et d’autres projets : elle veut chanter. Mais elle aidera tout d’abord son amie Suzanne à interrompre une grossesse. Nous sommes en 1962, à Paris la dépénalisation de l’avortement est attendue comme le messie (si l’on peut dire). Pour l’heure, il faut se serrer les coudes et glaner des informations sur les « faiseuses d’anges » à proximité. Cette entraide sororale scelle une amitié qui résistera à l’épreuve de l’absence et du temps.
Pauline et Suzanne se recroisent dix ans plus tard lors d’une manifestation pour le droit à l’avortement, impatientes de se raconter les années écoulées. Mais l’une vit désormais à Hyères et doit monter dans un bus, quand l’autre s’apprête à suivre son compagnon en Iran. Démarre alors une correspondance de cartes postales composées d’anecdotes brèves et intenses, ayant trait à l’amour, la solitude, le couple, la maternité.
Toujours d’une écriture profondément émouvante, Agnès Varda intervient parfois en voix hors champ comme une alliée précieuse, pour évoquer le temps qui passe et les aventures que traversent ces deux femmes désireuses de mener leur vie comme elles l’entendent. La voix de la cinéaste est le juste reflet de son regard et de son écriture, pleine d’empathie et de douceur, combinées à cette intelligente fermeté si caractéristique de son cinéma, qui combat les valeurs les plus conservatrices.
L’une chante, l’autre pas, comme l’indique son titre, est un film chantant – du moins en partie, et suffisamment pour être qualifié de musical.
C’est au premier tiers du film que survient un flashback décisif dans l’écriture musicale et narrative. Allongée dans un petit lit aux côtés de Darius, Pauline (renommée Pomme) n’a pas sommeil. Elle pense à Suzanne qu’elle vient de retrouver après dix années de silence, et à qui elle a tant de choses à dire. Elle se remémore sa rencontre avec Darius à Amsterdam, la fois où elle a dû voyager à son tour pour avorter. Elle raconte que ce qui l’a marquée, plus que son coup de foudre pour Darius, c’est son coup de tendresse pour les femmes présentes ce jour-là ; toutes réunies pour la même raison. La caméra balaye ces visages de femmes avec une force de présence particulière, tandis qu’une mélodie s’installe à faible volume en fond du flashback.
Maintenant j’allais chanter à mon idée, et pour ces femmes qui étaient ma famille. On était dans le même dortoir, dans la même galère, sur le même bateau.
À la façon d’une comédie musicale, la mélodie extradiégétique glisse et s’incorpore à l’action narrative. Pomme apparaît sur un bateau-mouche entourée de ses sœurs, et voguant sur les canaux d’Amsterdam entame la chanson des Nanavortées. Les paroles de cet hymne à la sororité sont à la fois tendres et solennelles, sans filtre édulcorant, graves mais colorées. Plus tard, Pomme chantera encore, mais les chansons seront dorénavant inscrites dans la diégèse du film, car jouées avec les Orchidées – un groupe de femmes itinérant qui sillonne les routes et se produit parfois en représentation sauvage sur les places des villages.
Les deux amies évoluent sur des destinées parallèles dont les temps-clés se répondent en écho, parfois à quelques années d’intervalle, les épreuves de l’une nourrissant celles de l’autre. Ainsi, dans la seconde partie du film, Suzanne rendra à Pomme la force que son amie lui avait insufflée au tout début de leur amitié.
Au travers de ces deux beaux portraits d’une puissance intemporelle rare, Varda parvient à faire se réverbérer au-delà de la caméra toute l’énergie frondeuse de ses personnages.
Et dans un geste d’ultime transmission, à la fois de femme, de mère et de cinéaste, elle capture sur pellicule la mélancolie du visage de Marie, la fille de Suzanne, incarnée dans le film par sa propre fille, Rosalie. Agnès Varda leur lègue ainsi à toutes deux le flambeau d’une lutte féministe à poursuivre vaille que vaille – une épopée indomptée qui continuera d’échapper aux angles d’une société borgne, boiteuse et manchote.
Février 2021
 L’une chante, l’autre pas, Agnès Varda, 1977
L’une chante, l’autre pas, Agnès Varda, 1977Mémoires de l’Homme Fente
Dans cette étrange période où les films ne sortent plus en salle, certains ovnis émergent d’ailleurs. C’est le cas de ce film sans images, œuvre si particulière dont la force créatrice repose sur une artiste aux multiples visages, Vimala Pons, autant actrice qu’autrice, et avant cela circassienne.
Expérience auditive convoquant l’intégralité des sens, et peut-être au-delà, on privilégiera une écoute au casque, allongé. L’exercice n’est pas si évident. Il faut d’abord réussir à relâcher suffisamment nos paupières tremblantes, faire le vide, et prendre perceptiblement la mesure des sons qui envahissent à la fois le corps, et le cerveau.
Nous sommes en 1997, Mikki Rappuleinen – peintre imaginaire – est présent à la vente aux enchères de ses propres œuvres. Il découvre au hasard d’une rainure de plancher que l’interaction de certains objets avec l’espace qui l’entoure est susceptible d’enrayer la marche normale du temps, de bloquer ou de distordre les gens et leur environnement. Plus surprenant encore, lui seul semble avoir le pouvoir d’agir sur ces interactions spatio-temporelles perturbatrices, en débloquant par exemple une fermeture éclair coincée dans un cadre de chaise en inox.
Des flashbacks du passé de Mikki viennent également perturber la courbe du temps et interrompre le commissaire-priseur, lorsque ce dernier n’interrompt pas lui-même les flashbacks pour annoncer la mise aux enchères d’une nouvelle toile.
Bruitages, chuchotements, nappes sonores, voix trafiquées aux accents très marqués, mélange des langues, détails outillesques d’une précision sans vergogne, réminiscences diverses… Notre cerveau est sollicité dans une substance imaginative qu’il ne se connaît pas encore. Le travail de l’écriture et du son confère aux images que l’on se crée une puissance singulière, une autre essence qui leur permet de s’ancrer de façon encore plus indélébile dans notre imagerie personnelle. D’insolites portraits se dessinent : la femme voilée au sandwich à la viande, un conducteur d’Airbus grippé, les deux hommes aux doigts entremêlés, Gloria Newprice… Des individus à l’allure messianique, qui par leur dénomination ou la précision de leur description s’assurent une représentation mentale robuste.
À travers l’évocation de relations intrafamiliales hors normes, ou le récit d’une rencontre amoureuse qui porte l’inhérence de sa chute, Vimala Pons dissémine des réflexions sensibles et philosophiques incisives ; toujours avec un ton qui ne se veut pas sérieux mais qui touche au cœur, dont l’humour et la trivialité défient la poésie.
Gloria était tout de suite tombée amoureuse de Mikki. Et Mikki était tout de suite tombé amoureux du fait que Gloria était tout de suite tombée amoureuse de ce qu’elle pensait être lui ; donc, de ce qu’elle voulait être elle.
Mémoires de l’Homme Fente est une lyre hallucinée complètement enivrante, laissez-vous voguer !
Janvier 2021
![]()
Mémoires de l’Homme Fente, Vimala Pons, 2020

Mémoires de l’Homme Fente, Vimala Pons, 2020
Lady Chatterley
Constance est engoncée dans un mariage de dévotion. Son mari, rescapé de guerre, est diminué dans ses fonctions vitales. Un matin, c’est Constance qui se sent trop faible pour se lever. Le médecin est inquiet, elle n’a pourtant aucune raison physique d’être au plus mal. Il est d’avis que Madame a besoin de prendre l’air, de se délester de certaines tâches.
C’est ainsi que Constance s’aère, et découvre en se baladant la cabane du garde-chasse, les poules, et les oisillons.
Pascale Ferran filme la nature avec la même générosité qu’elle applique à la captation des corps, et de magnifiques plans rapprochés de fleurs ou de cours d’eau occupent une vraie place au montage. « Je voudrais tant être un oiseau. » – cette phrase de Connie résonne avec enchantement quand on a vu Bird People. On ressent l’éveil des corps et de la nature dans le même temps, avec force.
Cet éveil, ni plus ni moins que la manifestation d’un désir ardent, occupe la place centrale de l’histoire, au point de ne pas laisser survenir dans le récit le drame potentiel des situations que pourrait générer ce désir. « Vivons, nous mettrons l’étiquette après. »
Le film tout entier reste concentré de bout en bout sur cette dualité douce, chez Constance, entre l’abnégation dont elle fait preuve dans sa relation avec Clifford, et le plaisir réel et sans culpabilité qu’elle vit avec Parkin.
L’adaptation dépasse la question des classes, qui à mon sens n’est pas l’enjeu principal de cette rencontre amoureuse. Les portraits ne sont pas simplistes, rien n’est complètement binaire. Clifford n’est pas la caricature du vil personnage, il peut presque se montrer touchant. Parkin quant à lui n’est pas l’alternative séductrice cliché de l’éphèbe, il se surprend lui-même à être l’objet d’un désir qu’il n’osait pas croire possible. La finesse de l’interprétation des acteurs va dans ce sens, il n’y a pas les bons d’un côté, ni les mauvais de l’autre.
Lorsque Parkin glisse pour la première fois lentement sa main jusqu’à la poitrine de Constance, il attend un refus qui ne vient pas. Dès cet instant, Constance accueille chacune des étapes que lui offre cette rencontre des corps, dans une progressive curiosité de l’autre. On dit que l’on brûle de passion, et Constance s’y donne complètement. Mais ce qui est particulièrement intéressant dans cette histoire de désir, c’est que la bascule ici n’est pas celle qu’on craint. Les pulsions de Lady Chatterley ne la condamnent pas à vivre dans le poncif péché de l’adultère. L’enjeu n’est absolument pas dans le fait de faire payer à l’héroïne le prix exorbitant d’un acte immoral. C’est pourtant si rare dans les récits romanesques de s’octroyer cette liberté de représentation du désir féminin, pas complètement en dehors, mais tout de même à côté du danger qu’il contient. En tant que spectateur, nous guettons forcément le drame, et le film est en partie construit sur cette idée ; nous attendons tout en le craignant, ce moment où Connie et Parkin seront pris en flagrant délit charnel. Alors quand ils courent nus dans les prairies, la crainte et la beauté sont à leur apogée. Et c’est justement à cet instant qu’on lâche prise, qu’on accepte tout l’enjeu, brut et plein, de leur histoire, qui ne sera jamais désamorcée par l’intrigue elle-même, et qui laisse le soin à ses personnages de questionner avec énormément de tendresse leur avenir.
Constance et Parkin n’entendent pas se quitter ni se lier, et n’ont pas pour dessein de nommer leur propre chute. Les personnages tiendront ainsi les rênes du film jusqu’au bout, sans laisser advenir le hasard comme vecteur de malheur ou de fatalité.
Octobre 2020
![]() Lady Chatterley, Pascale Ferran, 2006
Lady Chatterley, Pascale Ferran, 2006
 Lady Chatterley, Pascale Ferran, 2006
Lady Chatterley, Pascale Ferran, 2006Paterson
Est-ce le personnage qui porte le nom de sa ville, ou la ville le prénom de son personnage ? Peut-être la question ne se pose-t-elle pas en ces termes, peut-être doit-on omettre de penser qu’il existe un premier, puis un second. Car « Paterson » ne s’entend ni tout à fait comme un lieu, ni tout à fait comme un être humain. Il s’agit d’une sorte de mot patronymique, entre l’entitaire et l’identitaire, qui représente et porte symboliquement la filiation d’une certaine poésie. Pater-son.
Paterson est le conducteur d’un bus qui sillonne les rues de Paterson, et l’auteur de poèmes consignés dans un petit carnet secret. Il partage sa vie avec Laura, artiste aux multiples facettes qui peint des motifs concentriques ou zébrés sur les murs, les tentures, les coussins, les cupcakes. Tout de noir, et de blanc. Il y a aussi Marvin, un bouledogue rival et possessif que Paterson emmène en balade chaque soir, la nuit tombée.
On suit le personnage éponyme dans son quotidien, du lundi au dimanche d’une semaine en apparence plutôt tranquille. Il se réveille le matin grâce à une horloge interne bien réglée, avec juste ce qu’il faut de marge d’erreur pour distiller un peu d’aléatoire dans le commencement de ses journées. Le lundi, la manipulation d’une boîte d’allumettes déclenche l’écriture d’un poème. On entend d’abord la voix mentale du personnage, qui pèse et répète les mots du poème naissant. Puis, une fois ces mots bien imprégnés de toute leur consistance, Paterson les couche sur le papier de son carnet, dans le même temps qu’ils s’inscrivent lentement en lettres manuscrites dans le corps de l’écran.
Le cinéma de Jim Jarmusch a ceci de fascinant qu’il installe un suspense certain, mais face à une routine qui ne se laisse pas intimider, dans une sorte de torpeur légèrement inquiétante, sans jamais faire la fausse promesse d’un bouleversement scénaristique majeur, et sans non plus donner la certitude que les choses resteront telles qu’elles sont. C’est l’aplomb d’une mise en scène qui reste sur la brèche, avec cette musique déclinante, à la lisière de la mélancolie. Chaque instant est nappé d’une poésie à la fois sereine et trouble. On sait que quelque chose surviendra, mais quoi ?
Pas de drame spectaculaire de prime abord. Aucune scène de ménage, aucun accident de bus – tout au plus une panne électrique qui n’engendrera quasiment pas d’incidence sur le récit, ou si peu ; mais justement ! C’est l’art de ce film-poésie en gouttes de pluie. Rien n’est grave, la catastrophe est immense. À qui veut bien contempler le monde, tout peut chavirer. Et en un sens Paterson chavirera intérieurement, mais pour mieux s’amarrer à l’essentiel. Car si les personnages sont bigarrés, ils possèdent aussi un ancrage fort avec le réel. Ainsi Laura déborde-t-elle d’une vitalité artistique puissante, mais dont l’excès n’entame pas la stabilité. De la même façon, le calme de Paterson ne déguise pas de pathologie dormante, mais ce calme doit exister en contraste et miroir des chutes d’eau de la ville qu’il observe avec tant d’acuité. Comme une condition à la réception du monde.
L’étrangeté s’invite dans les journées de Paterson par l’apparition récurrente de personnages jumeaux – lesquels, sur un banc, à bord du bus ou attablés au bar, semblent battre les cartes d’un duel métaphysique. Ces jumeaux pourraient être la symbolique d’une présence double au sein d’une seule et même personne, mais aussi la représentation de l’altérité au sens de la fusion de deux êtres. Comme tout un chacun chemine lentement vers son alter ego, le film fait la passerelle entre l’autre, et soi, et l’autre soi.
De la beauté de l’évidence, du hasard de l’attraction. Les doubles s’aimantent, dans l’inquiétude paisible du temps qui s’accomplit.
Octobre 2020
![]() Paterson, Jim Jarmusch, 2016
Paterson, Jim Jarmusch, 2016
 Paterson, Jim Jarmusch, 2016
Paterson, Jim Jarmusch, 2016Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait
Un titre qui annonce déjà l’idée d’une contradiction, ou du moins la possibilité d’un embranchement. Je pense à cette délectable confrontation au cinéma, du langage de l’image et de celui des mots, que l’on peut s’amuser à étudier, encore et toujours, dans les films d’Éric Rohmer. Haydée ressurgit sous mes yeux, et ce personnage, aussi intemporel que son prénom, représente pour moi toute la démonstration de cette question de cinéma : ce qui est montré à l’écran, et ce que les mots apportent conjointement, en contradiction parfois. Dans La Collectionneuse, les gros plans d’Haydée au bord de l’eau viennent démentir les paroles d’Adrien, faussement désintéressé ni maître de son désir. Dans le dernier film d’Emmanuel Mouret, l’image agit également comme révélateur : le spectateur est informé avant les personnages de leur propre duperie.
François a dû s’absenter et ne peut accueillir son cousin comme prévu. C’est ainsi que sa compagne, Daphné, rencontre Maxime à la gare d’Avignon. Au gré de leurs balades touristiques, les deux personnages vont se confier leurs histoires de sentiments – comme se plaît à les nommer Maxime. Cette nuance d’appellation, entre l’amour et les sentiments, permet d’aborder le film avec un regard beaucoup plus large, qui tout à coup embrasse avec plus de subtilité le spectre des possibilités sentimentales. Renommer l’amour, c’est faire un pas de côté, élargir les sentiers. Ce n’est pas ôter la gravité, mais c’est oser redéfinir les règles d’un domaine souvent très codé par les mœurs.
D’histoires de sentiments donc. Maxime raconte à Daphné ses tortueux déboires avec Sandra, et Daphné raconte à Maxime l’étrange évolution de sa relation avec François.
Le tressage romanesque de leurs histoires donnerait presque envie de sortir un carnet et de tracer des lignes, des bulles et des flèches. Faire le schéma de ces relations qui se croisent et s’enchâssent, dans de grisants allers-retours.
La première moitié du film est en grande partie consacrée à ces récits du passé, qui occupent également l’écran, et nous transportent à Paris – on a la sensation d’avoir pris le train en marche arrière depuis Avignon. Des retours au présent ponctuent le film comme des transitions durant lesquelles Daphné et Maxime échangent quelques mots sur ce qui vient d’être raconté, puis se passent en quelque sorte le flambeau, chacun à leur tour reprenant le fil de l’histoire à conter. Le temps de deux journées défile. Les levers et les couchers du soleil nous confirment que les flashbacks sont bel et bien contés dans un espace-temps lui-même en mouvement, et les tables de chevet des différentes temporalités se confondent, avec une amusante et déroutante similitude.
A mesure que l’on apprend à connaître les personnages, par le biais de leurs histoires de cœur, se dessine perceptiblement l’idée qu’il n’y a rien d’anodin à observer Daphné et Maxime visiter des sites historiques, marcher dans la rivière, ou préparer un repas. Ils sont un couple, au sens du duo qu’ils forment, par l’absence de François. Et même s’ils feignent, pour eux-mêmes et pour le spectateur, de n’être que les simples conteurs de leurs histoires passées, force est de constater qu’à l’image, la partition de leur rencontre se joue. Une nouvelle histoire est en train de s’écrire.
L’immense beauté de ce film, c’est de ne brusquer par aucune démonstration de force la progressive coexistence de sentiments pluriels. Car il serait absurde de trop appuyer la revendication d’une idée morale qui ne s’affirme pas comme telle. C’est toute la simplicité de cet état de fait : puisqu’il en est ainsi, et non autrement. En ce sens le film est tout à fait brillant, car la puissance et la sincérité des sentiments contournent la question de l’approbation du spectateur. On n’adhère pas à une décision éthique, on acquiesce à la réalité d’un désir, indépendamment de la question d’y céder ou non.
Plusieurs points de climax échafaudent le film, comme autant de ponctuations aux différents chapitres des récits, et les musiques de Debussy ou de Chopin viennent parfois complètement couvrir les paroles des protagonistes, à la façon d’une vague submersive.
Aussi le film est-il presque écrit en contrepoint, dans un temps où mouvements montants et descendants se superposent, pour créer différents croisements d’émotions et de pensées d’une profonde intensité.
Septembre 2020
![]()
Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Emmanuel Mouret, 2020
EN SALLES LE 16 SEPTEMBRE

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, Emmanuel Mouret, 2020
EN SALLES LE 16 SEPTEMBRE
Kajillionaire
Une jeune fille aux longs cheveux blonds, fagotée avec des vêtements de sport trop grands et un sac à dos, effectue des acrobaties tout à fait comiques afin de pénétrer dans un hall de poste sans être vue. Le but : dérober du courrier haut de gamme. Un braquage de banque sans argent en somme, où l’idée du brigandage réside plutôt dans le geste de transformer les objets en or ; on vole un colis dans un casier, on extorque un bon pour un massage, puis on espère réussir à les troquer.
On se croirait entre Bottle Rocket et la Famille Tenenbaum – Bottle Rocket pour l’association de malfaiteurs, les Tenenbaum pour la famille marginale aux lourds problèmes affectifs.
Mais il s’agirait presque d’un malentendu de vouloir trop associer Kajillionaire à Wes Anderson, car le film nous emmène progressivement dans une nouvelle étrangeté complètement caractéristique du cinéma de Miranda July.
À 26 ans, Old Dolio n’a pas encore pris le temps de se questionner sur son individualité propre. Elle a grandi sans l’amour de ses parents, considérée au mieux par eux comme une égale avec laquelle partager les parts d’un butin. Elle doit faire ses armes dans la vie avec cette éducation atypique, entre les magouilles burlesques et les reports de loyer pour un taudis dont les murs suintent la mousse rose à heures fixes.
Le filme glisse lentement vers la découverte d’une gestation intérieure, qui n’est pas celle d’une maternité effective, mais dans laquelle il se rejoue la préparation d’une naissance. Car envisager de couper le cordon présuppose l’existence d’un lien maternel, et une conscience de son corps ; ce qui n’était pas le cas pour Old Dolio.
La noirceur malaisante des parents assimilée au rose onirique des bulles de savon crée une zone d’étrangeté lévitante. Nos affects demeurent en suspension, comme des molécules à traiter a posteriori. Spectateurs désarçonnés, nous devrons buller en nous-mêmes pour recréer le magma des émotions gelées. Effroi, tendresse, dégoût, empathie. Du rire à la plus infinie des mélancolies, il n’y a qu’un pas, toujours. Et Miranda July relève ce défi fou de nous libérer avec son personnage des aliénations résiduelles les plus taboues ; celles dues à l’éducation, et même avant cela, au carcan matriciel qui nous a donné la vie.
Old Dolio est un être en mue, une forme mouvante, élastique. Elle se contorsionne, elle rampe. Privée de la vie et de son corps depuis toujours, elle éclate sa chrysalide dans une expression d’elle-même mi-monstrueuse, mi-sublime. Sa rencontre avec Melanie est l’agent révélateur d’un autre regard possible, sur la vie, l’amour, la sensualité.
Le choc émotionnel qui traverse Old Dolio nous atteint par le biais d’un choc esthétique, dans une scène clé qui catalyse tout l’enjeu du film, lorsqu’un séisme secoue Melanie et Old Dolio dans l’obscurité des toilettes d’une station-service. La réalisatrice réussit avec hardiesse le pari d’un voyage infini, par la simple insertion d’un plan sombre duquel émerge discrètement des points lumineux. Comme si l’idée était laissée au spectateur qu’il est lui-même l’auteur des astres qui s’imposent à son œil, dans une sorte de persistance rétinienne génératrice de nouvelles formes.
Décoller de sanitaires lugubres pour atterrir dans le cosmos : quelle audace, quel geste de cinéma !
Bienvenue dans la réalité transcendée de Miranda July.
Septembre 2020

Kajillionaire, Miranda July, 2020
EN SALLES LE 30 SEPTEMBRE
EN SALLES LE 30 SEPTEMBRE
Eva en août
Il est encore août, il est encore temps.
Excepté un bruit de ventilation ininterrompu qui m’évoque le tambour d’un lave-linge, c’est le désert calme dans la salle de cinéma.
Eva surgit silencieuse, jupe ou pantalon de jean. Elle associe les pois et les couleurs, mandarine et grenadine. C’est la chaleur estivale madrilène, peu d’air circule entre les pièces. Son hôte lui montre les volets de bois, et la chambre, un peu plus épargnée du soleil. La porte de l’entrée principale est capricieuse, mais ça ira. Elle récupère les clefs.
À la découverte de sa propre ville, Eva observe les touristes ; une tout particulièrement, à bord d’un bus à deux niveaux, qui sourit aux paroles de l’audioguide. Eva la suit jusqu’au musée, et s’immobilise de façon mimétique devant les statues romaines.
Emprunter les yeux d’une « étrangère » est le moyen de porter un nouveau regard sur son environnement, et dans un éloge de la lenteur, de se laisser surprendre par ce qu’elle croyait familier.
Le temps s’étire au rythme des rayons du soleil, et laisse se conjuguer hasards et imprévus.
Eva retrouve un vieil ami journaliste, et une amie d’enfance devenue mère. Coincée au bas de son immeuble, elle rencontre aussi une voisine d’origine allemande, qui s’avère être l’artiste qui performait à la terrasse du café quelques heures plus tôt.
Au bord de la rivière, ils discutent tous de leur expérience du voyage. Comment devient-on adulte, comment devient-on qui l’on est vraiment ? Pour beaucoup d’entre eux, c’est en quittant une terre natale. Eva est songeuse, elle n’a jamais quitté Madrid.
Le film alterne des scènes de vie agitées à l’extérieur, avec des scènes plus feutrées dans l’appartement. On ressent une indolence mêlée d’impatience, lorsqu’Eva est à demi allongée sur le canapé, le lit ou le balcon – espace où s’entrelacent le plus les humeurs, entre le dehors et le dedans. Eva joue avec les lumières et l’effet réverbérant de son iPhone, et le film s’amuse de la poésie de ce geste, à la croisée de l’intemporel et de l’ultracontemporain.
Eva a 33 ans ; lorsqu’on lui demande ce qu’elle fait dans la vie, elle répond qu’elle était actrice. « Comment peut-on ne plus être actrice ? », lui rétorque Olka. Mais pour Eva, il s’agit d’un métier comme un autre, dont on peut parler au passé.
Ce qui est certain, c’est que le passé de la protagoniste ne nous est que peu révélé, mais l’on devine derrière ses grands yeux toujours embués une émotion à vif, qui se digère dans le même temps que l’on regarde le film. On vit à l’unisson avec ce personnage incarné par Itsaso Arana, si intense, si juste et sincère. Tout est question de communion, avec les gens mais aussi avec les éléments.
En étoile de mer dans la rivière, Eva contemple le ciel, et dans un savoir-être ultime, elle lâche prise.
En toile de fond la lune, à plusieurs reprises dessine ses ellipses. À son contact Eva se transforme, plutôt qu’en loup-garou, en madone. Qu’il s’agisse d’un miracle ou seulement d’un mystère. Ainsi soit-il.
Août 2020
![]() Eva en août, Jonás Trueba, 2020
Eva en août, Jonás Trueba, 2020
 Eva en août, Jonás Trueba, 2020
Eva en août, Jonás Trueba, 2020Tenet
Dans la salle de cinéma, nous sommes nombreux pour l’avant-première. Temps Covid oblige, je décide de rester masquée, ce qui provoque une sensation assez vertigineuse avec la scène d’ouverture ; un opéra, salle comble, sujet d’une attaque terroriste et de l’intervention de la CIA, avec des hommes masqués eux aussi, et la diffusion d’un gaz soporifique. Le public de l’opéra s’endort mais de l’autre côté de l’écran on est bien éveillés, c’est un peu une séance 3D avec des accessoires différents. Plus tard, certains des protagonistes du film portent encore d’autres masques, tandis qu’on étouffe à demi sous les nôtres, et sans aller jusqu’à dire que j’apprécie la sensation, il se crée pourtant une connivence avec les personnages. Reliée à eux, le bruit de leur respiration dans le masque à oxygène accompagne le souffle chaud qui se répand à l’intérieur de mon masque chirurgical.
Tenet : palindrome mutique, vague scélérate à lui tout seul, qui résume le film autant qu’il le tait.
Un peu abasourdie par les basses, divers éclats sonores et visuels en rafale, j’essaie de comprendre où nous emmène Christopher Nolan. J’ai la désagréable première impression des films d’espionnage qui vont trop vite, où « l’on comprend pas bien mais on parie sur la suite ». On fait le parallèle avec James Bond ou Mission Impossible, car dépasser l’impossible, il est en question très vite.
Étonnamment, ce brouhaha d’incompréhensions, à mesure qu’il s’épaissit me séduit, musclant mon cerveau à la lecture de l’intrigue. Il est question de sauver le monde, de guerre et d’inversion temporelle – une sorte de voyage dans le temps mais plus complexe, moins magique, qui se veut plus physique et presque palpable. Cette inversion est essentiellement matérialisée par les impacts des armes à feu. Il y a des trous, des cratères et des démolitions, que le temps inversé, sans en annuler véritablement les effets, répare en redonnant des formes pleines aux surfaces brisées. On ressent de ce fait plus fortement les vides et les blessures créées par les combats, car l’inversion ne fait que recouvrir les traces d’un passé mutilé, sans en effacer les collisions. Elle engloutit, sans jamais digérer tout à fait, emprisonnant les lésions dans le désordre entropique des matières.
C’est probablement tout l’enjeu et la subtilité de cette inversion temporelle, qui n’a rien d’une simple excursion. Ici, on manipule le plutonium avec précaution, on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. C’est « le paradoxe du grand-père », ainsi que le nomment les protagonistes. Tu ne peux pas supprimer la génération qui t’a fait voir le jour, sous peine de te supprimer toi-même.
Le temps inversé c’est aussi marcher à reculons, ou rembobiner une bande-son qui dévoile un nouveau langage, à la façon des messages subliminaux glissés dans les variations de vitesse d’un disque vinyle. Un personnage devient inintelligible, un oiseau chante autrement. Kat, d’ailleurs, dans le film, exprime clairement qu’elle ne s’habitue pas au chant inversé des oiseaux. Cela me fait penser après coup à cette magnifique chanson d’Aldous Harding, What If Birds Aren’t Singing They’re Screaming. Oui, et si ce nouveau chant n’était pas un chant mais un cri. Alors Tenet serait comme la révélation de doubles lectures, et l’agent double de mouvements contraires. À tel point que les personnages finissent parfois par comprendre qu’ils ont livré bataille contre eux-mêmes, dans un présent qui n’existe plus que sous ses formes passées et futures, entremêlées.
Août 2020
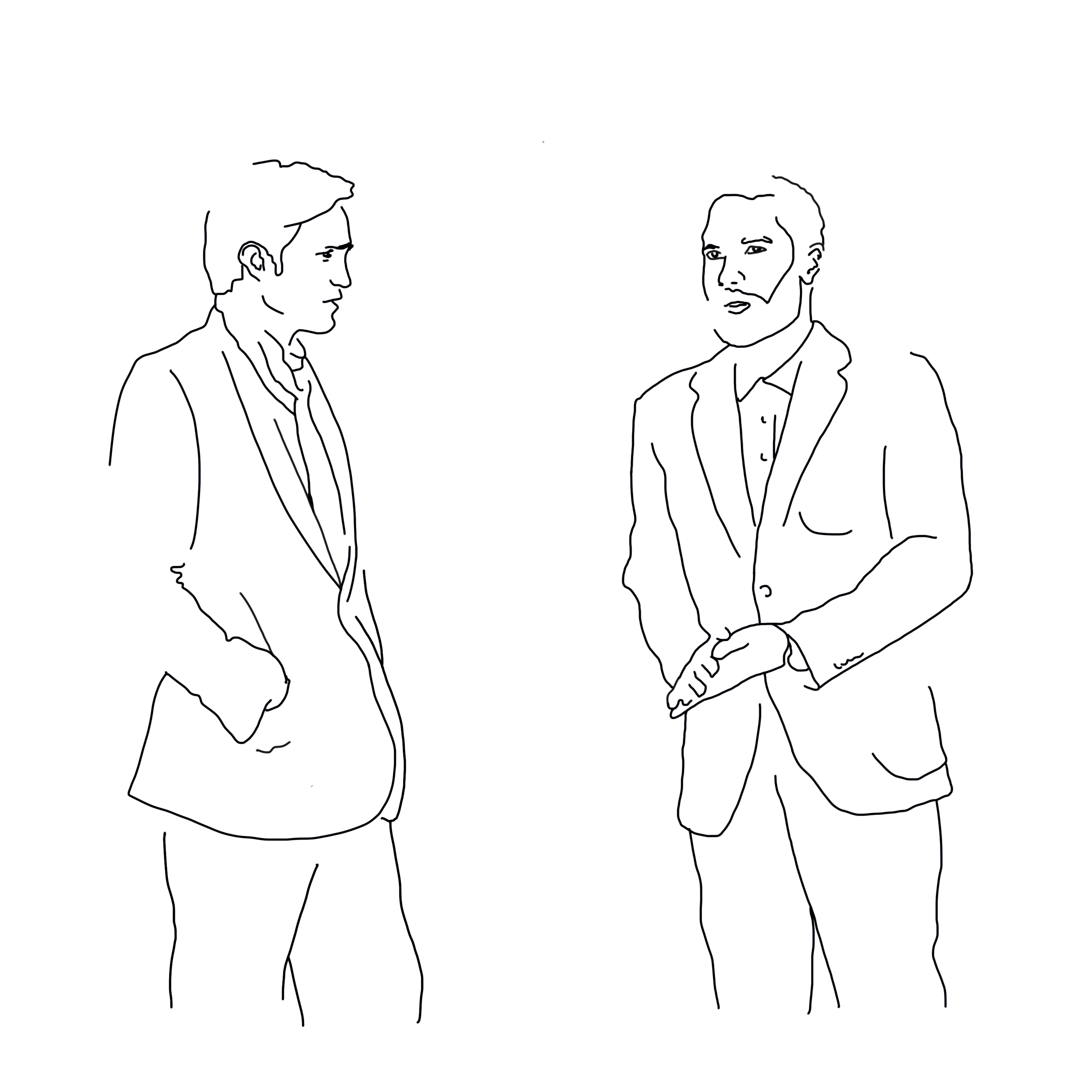
Tenet, Christopher Nolan, 2020
Ma nuit chez Maud
« Ce jour-là, 21 décembre, l’idée m’est venue, brusque, précise, définitive, que Françoise serait ma femme. »
Énoncée de but en blanc, cette phrase résonne comme une incongruité fortuite.
D’ordinaire, il y a les visages anonymes, mais ici c’est davantage le prénom qui peine à s’identifier, et semble courir après son visage. Il y en a bien un, celui d’une femme blonde, dans une église pendant la messe ; puis le prénom, lâché sur les images enneigées d’une rue. Cette phrase en voix off si fortement anachronique, autant qu’intemporelle, ou irréelle, contient en elle seule tout le pari du film et de son personnage.
Jean-Louis est ingénieur, de retour de l’étranger. Catholique pratiquant, on comprend rapidement qu’il n’a pas toujours eu la vie morale qu’il estime devoir désormais être la sienne.
Il croise le chemin d’un ami de jeunesse, Vidal, au hasard d’un bar dans lequel ni l’un ni l’autre ne vont jamais.
Oui, car dans tout le champ des possibles, si l’on peut s’amuser à estimer le pourcentage de chances de croiser quelqu’un dans un lieu que l’on fréquente quotidiennement, qu’en est-il des probabilités avec les lieux que l’on ne visite jamais ? Les mathématiques ont leurs zones d’impuissance, et c’est à partir de ce premier débat que Vidal et Jean-Louis vont dériver vers Pascal. Pascal et son Pari.
Le pari pascalien tient en ce défi fou de croire. Si l’on croit, et qu’il s’avère que Dieu n’existe pas, on ne perd rien (sinon notre croyance). À l’inverse, si Dieu existe bel et bien, ne pas croire nous expose au risque d’être damné.
Ce pari semble être le point de départ et de convergence des fils narratifs de Ma nuit chez Maud.
Plus qu’en Dieu, Jean-Louis croit en son pouvoir d’intuition hégémonique, sur sa vie amoureuse mais donc aussi sur les femmes. Françoise n’en sait rien, mais elle sera sa femme, envers et contre toute autre rencontre.
Cette autre rencontre justement, lorsque Vidal l’invite à dîner chez Maud, Jean-Louis en fait l’expérience tortueuse.
Quelle est donc cette morale si prégnante qui s’impose contre l’évidence des attractions ? S’agit-il véritablement d’une idée morale, ou bien d’un jeu de dupes, ou encore d’une conviction qui repose sur la seule décision de ne pas y déroger ? Cette longue nuit chez Maud ne fera qu’accentuer tout le nébuleux de la dérobade.
La rencontre est pourtant l’ici et le maintenant. Maud est incontestablement l’héroïne du film. Et par la force cinématographique de ce personnage féminin, Rohmer semble distiller l’idée que Françoise n’existe pas, du moins pas en tant que personnage de cinéma.
L’épreuve de résistance à laquelle est ensuite confronté le spectateur est assez puissante. La dernière partie du film est comme vouée à l’oubli. Après cette nuit chez Maud, la rencontre entre Jean-Louis et Françoise, née d’un calcul arbitraire et souverain, nous prive avec le protagoniste de toute résonance avec son dessein.
Françoise a la pâleur exsangue des personnages secondaires, de ceux même qui n’auraient pas été réellement conviés à jouer. Mais Jean-Louis reste béat d’accomplir sa destinée, de s’être nommé résolument maître d’un choix moral scellé et éternel.
À l’austérité du ton et de l’image se détache finalement une cabriole narrative très rohmérienne. Françoise, malgré toute l’autorité morale que Jean-Louis plaque de force sur son identité, se révèle avoir un passé propre, avec des rencontres qui ne cesseront jamais de n’appartenir qu’à elle.
Ainsi échappe-t-elle au projet aveugle et abscons de son mari, et, le regard fuyant, redessine les contours de l’histoire.
Il n’y a rien de plus savoureux qu’un croisement de lignes si lentement prévisible, tant ironique, si peu docile.
Mai 2020
![]() Ma nuit chez Maud, Éric Rohmer, 1969
Ma nuit chez Maud, Éric Rohmer, 1969
 Ma nuit chez Maud, Éric Rohmer, 1969
Ma nuit chez Maud, Éric Rohmer, 1969Lincoln
La question que l’on doit peut-être se poser avant toute chose est la suivante : qu’attendons-nous d’un film historique ?
Lincoln retrace les jours qui précèdent le vote du Treizième amendement de la Constitution des États-Unis – l’éminemment célèbre amendement de l’abolition de l’esclavage –, et ces jours, empreints d’une forte attente, n’ont pas nécessairement été marqués par le spectaculaire. Il s’agit de journées durant lesquelles Abraham Lincoln et ses conseillers parlementent, et cherchent à obtenir les voix manquantes pour ledit vote.
Le film déstabilise d’emblée par son aspect un peu rêche, aride. La récurrence des entrevues et réunions soulèvent toujours la même question, à savoir le maintien du souhait du président de faire voter cet amendement à la fin du mois. Tout est construit sur une idée politique tenace, sans débordement, ni grand rebondissement.
Cette démarche peut paraître tout d’abord d’un ennui fort et singulier, mais se révèle petit à petit un enjeu majeur de la mise en scène de Spielberg.
Car ce que l’on comprend progressivement, c’est qu’un tel amendement ne verra pas le jour sans le suffrage d’hommes parfois à peine favorables à l’abolition de l’esclavage. Mais ce qui importe à Abraham Lincoln est davantage la fin que les moyens utilisés pour y parvenir. Favorable aux compromis, le président temporise, et se sert de la guerre qui sévit comme d’un levier indispensable. Tout ne tient qu’à un fil, et tout n’est que tactique.
Le pari cinématographique de ce film historique réside dans le fait de nous montrer combien la valeur d’un acte héroïque ne se calcule pas en démonstrations épiques, mais plutôt en l’addition et la répétition d’une parole inflexible. Abraham Lincoln apparaît comme un président obstiné, d’un tempérament placide, haussant brièvement la voix ou tapant ponctuellement du poing lorsque sa famille et les affaires le réclament.
Croisant ses vies intime et politique – et comment pourrait-il en être autrement dans le décor d’une Maison-Blanche ? –, Spielberg construit avec subtilité le portrait d’un homme de pouvoir, d’un mari et d’un père.
Parfois des objets, des étoffes, ajoutent des détails sensibles à l’édification et l’héroïsation du personnage. Des pantoufles, une paire de gants, un chapeau, un rideau, seront autant d’accessoires humanisés et délaissés, effleurés, qui dans une mise en scène terne et poussiéreuse apporteront la pâleur lumineuse du vague à l’âme.
C’est ainsi qu’imperceptiblement, on se laisse émouvoir par le jeu de Daniel Day-Lewis ; et du même regard que son majordome, empli de sollicitude, on regardera la silhouette claudiquante du président s’éloigner lentement vers son destin tragique.
Mai 2020

Lincoln, Steven Spielberg, 2012
Pyrale
Tandis qu’une nuée de papillons s’apprête à envahir la Drôme, des jeunes gens attendent avec impatience le feu d’artifice de la mi-juillet…
Les vies sont des drames et des romances. Au sortir de l’adolescence, il y a la puissance des possibles et de l’inconnu, la sincérité des regards qui s’affolent et la solitude des soirées d’été…
L’été justement, celui d’après bac : un temps suspendu entre deux âges. On n’est pas encore tout à fait soi, mais on l’est paradoxalement avec plus de vérité et de fougue que dans certaines vies d’adulte endormies.
Roxanne Gaucherand s’intéresse au point de bascule à la fois tendre et cruel qui s’opère lorsqu’on ne sait plus si l’on aime d’amitié ou d’amour, à l’âge des premiers émois, quand les sensations n’ont pas encore leurs mots propres, et que chaque parole ou geste peut décupler au centuple ses effets.
Pyrale a ceci de singulier qu’il s’agit d’un film construit sur deux trames : l’une fictionnelle, l’autre documentaire. Et ne se niant pas l’une l’autre, ces deux trames avancent et se nourrissent, faisant progresser un récit non-binaire basé sur l’amour – l’amour des humains mais aussi et surtout celui de la nature.
L’intérêt de ce pari, c’est que la partie fictionnelle et celle documentaire ne sont en apparence pas basées sur le même arc de narration ; la fiction serait l’amour adolescent, le documentaire la pyrale du buis (petit insecte séduisant ravageur).
Mais des parallèles se forgent progressivement, et la rencontre de Lou et du papillon permettent de créer une zone miroir, où battements de cils et battements d’ailes se répondent, dans une étrange prise de conscience de soi et de l’altérité.
La lumière œuvre dans le film comme un couteau suisse. Lune, soleil, feu, fluo, tungstène. Tantôt diffuse, tantôt émanant des écrans de smartphones, en tant que piège à pyrale, ou repère dans la nuit, elle éclaire, pailletée, un visage bleuté ou la tension orangée d’une rue déserte.
Lorsque les habitants ferment leurs volets, nous devenons les témoins silencieux des différentes mutations du vivant, et dans une sorte de crainte qui devient l’alliée de la fascination, on assimile petit à petit les défis que nous lancent nos nouveaux écosystèmes.
Avril 2020

Pyrale, Roxanne Gaucherand, 2020
Slacker
Slacker est l’un des premiers films de Richard Linklater, sorti pour la première fois en 1991, et réapparu en version restaurée sur nos écrans ce début d’année – comme une étoile filante, sitôt sorti en salle, sitôt disparu, mais offrant au témoin observateur la croyance que quelque chose a bien eu lieu.
Le premier personnage que l’on rencontre à bord de ce film, incarné ni plus ni moins par le réalisateur lui-même, est un jeune homme vagabond, passager d’un car puis d’un taxi, dans lequel il nous livre le monologue probablement le plus marquant de tout le film ; monologue sur la théorie des réalités parallèles, en prenant l’exemple de sa propre situation : il aurait très bien pu décider de marcher plutôt que de prendre le taxi.
Grosso modo : et si les différents embranchements, au carrefour d’une vie, créaient tous des réalités quelque part, chacune dans un monde en soi ? Peut-être sommes-nous alors en train de vivre l’alternative d’une autre situation, elle-même pourquoi pas plus réelle que la réalité que nous sommes en train de vivre ?
Le ton est donné. Cette entrée en matière des plus cavalières, sans crier gare, à l’écoute indifférente d’un chauffeur de taxi, fait rire et réfléchir le spectateur tout de go, plongé dans un bain de mots qui questionne sans ménagement l’existence et la réalité.
Sortie du taxi. Travelling latéral dans le sens de la marche. Soudain, le jeune vagabond assiste à un délit de fuite. Une automobile vient de renverser une femme qui gît désormais sur la route, le contenu de ses courses déversées alentour. Presque simultanément a lieu la rencontre avec une joggeuse, qui continue de jogger à hauteur du corps en faisant du surplace. Elle s’adresse au jeune homme sans émotion, avec un débit similaire et le même détachement humoristique que celui adopté à bord du taxi.
Travelling arrière inopiné. On comprend alors que cette scène, si intrigante qu’elle soit, ne sera vraisemblablement qu’une scène parmi d’autres, la première de nombreux autres glissements et détournements du regard. Un nouveau décor en mouvement se construit à mesure que la scène de l’accident rétrécit et continue d’avoir lieu sans nous. On entendra les sirènes policières plus tard, depuis l’appartement d’un nouveau protagoniste apparu quelques instants plus tôt dans la champ de la caméra, lors de son entrée dans un immeuble découvert par le zoom arrière.
Il en est donc ainsi du concept du long-métrage de Linklater. Les enchaînements scéniques se feront au gré de rencontres dans les rues d’Austin, Texas. Cette ville est représentée comme le théâtre de toute une jeunesse oisive, libre et livrée à elle-même. Chaque rencontre est déterminée par le récit d’un personnage, souvent fantasque et animé de croyances complotistes. L’un d’eux parlera même de son futur livre à paraître, dont le titre reste à déterminer : Anthologie de la couardise ou bien Conspiration à gogo ; comme une mise en abyme du film lui-même, Slacker signifiant fainéant.
Entre tendresse et auto-dérision, Linklater dresse le portrait de sa génération, laissant sourdre la désespérance d’une jeunesse adulte qui peine à trouver un sens à son errance.
L’amusement du relais fait naître petit à petit un sentiment plus diffus de malaise social. L’inquiétante drôlerie de leurs récits, entre magouille onirique et délire existentiel, dont la succession nous divertit tout d’abord, fait grandir dans le même temps un sentiment un peu anxiogène, de voir se suivre et se répéter des récits qui, bien que différents dans leur forme, racontent au fond tous la même chose. Ces habitants d’Austin ne sont intégrés à aucun modèle socio-professionnel, et cherchent à l’inverse à s’éloigner au maximum d’une affiliation, fondant ainsi une communauté de slackers (terme à définir finalement avec davantage d’ambivalence que sa définition première). La fainéantise serait alors une sorte d’issue indéterminée mais choisie. Se positionnant à l’extérieur d’un ordre établi, ces baby-boomers recherchent constamment à créer leur singularité dans l’existence, déconnectés de la notion du « faire carrière ».
Les deux dernières scènes du film – à l’image du ton paradoxal qu’emprunte ce drame facétieux – se succèdent dans une ultime pirouette formelle.
Un individu aux allures de fin du monde, diffusant à bord de sa voiture un message terroriste amplifié, croise la route d’une autre voiture remplie de joyeux lurons, braquant sur lui des caméras Super 8. Une réponse efficace à cette incitation à l’armement.
S’opère alors une passation dans l’image, comme si nous sautions d’une voiture à l’autre. Nous rejoignons la voiture des filmeurs, et ce qu’ils filment vient alors remplacer la bande originelle du film. À la façon d’un hold-up, ces jeunes se sont emparé du dispositif filmique et rabattent le clapet de l’orateur funeste.
Linklater nous livre une dernière scène d’aventure embarquée, réjouissante escalade en musique, où la caméra, plutôt que de nous donner le mal de mer nous transporte gaiement, et ensuite au sommet d’une montagne, larguée dans les airs nous offre le tournis d’une révolte qui n’a pas fini d’affirmer son opposition.
Février 2020
![]()
Slacker, Richard Linklater, 1991

Slacker, Richard Linklater, 1991
Une vie cachée
Comment sortir complètement indemne d’un film qui s’éprouve à tant d’immersion ?
Nous connaissons désormais bien Terrence Malick. Les mouvements de sa caméra, et la proximité qu’elle entretient avec les corps, selon les sujets peut se révéler merveilleuse ou étouffante. Une certaine appréhension m’envahit donc sur le seuil de la salle obscure : qu’en sera-t-il, cette fois-ci ?
Une vie cachée déborde dès les premières images d’une nature immense, qui prend sa hauteur sur le monde, comme en retraite des combats humains, quelles qu’en soient l’époque et la civilisation.
Franz et Fani cultivent leur terre dans le village de Radegund, en Autriche, et vivent sereins avec leurs trois filles.
Cette accumulation de plans heureux, d’une famille dévalant les pentes verdoyantes, s’étreignant et jouant sans cesse, inondant d’un amour tactile l’intégralité de l’écran, peut rapidement conduire à l’écœurement. Si près des corps, des cheveux et visages, des mains terreuses, nous sommes comme cajolés de force dans une intimité qui n’est pas la nôtre.
Nous ne savons pas encore si nous acceptons d’être plus que de simples témoins. Ce questionnement restera en suspens les deux premiers tiers du film, car comme dans beaucoup de long-métrages dont la durée approche les trois heures, les réponses adviennent souvent très tard, et nous récompensent parfois d’avoir accueilli avec confiance une intrusive confidence.
Nous sommes au début des années 1940, Franz craint à tout instant d’être appelé pour défendre sa patrie. Il refuse de porter allégeance au Führer, car grandit en lui l’intuition ardente qu’il ne peut pas faire ce qui lui semble être le mal.
Cette intuition muette et croissante, que questionnera silencieusement sa femme – beaucoup moins silencieusement les habitants de Radegund –, sera très rapidement vecteur de tension et d’animosité dans le village. Son positionnement est interprété comme un acte de lâcheté, voire une provocation face à la bravoure des autres.
Le temps passe ainsi dans les montagnes, dans une forme d’errance suspendue. Franz fait son chemin de croix, parcourant les sentiers, guettant et espérant ne pas entendre la bicyclette du facteur. Il interroge Dieu à travers prêtre et évêque, n’obtenant tout au plus qu’un peu d’empathie, mais aucune ligne de conduite à suivre en cohérence avec ses convictions.
Il est seul, profondément seul dans son cœur, excepté lorsqu’il étreint sa femme, chez laquelle le sourire se révèle parfois l’écho de ses certitudes.
Peu de surprise dans l’enchaînement des événements. Franz vivra un longue descente dans l’obscurité, recherchant du fin fond des cellules de prison le souvenir lumineux de ses terres.
Sondant la gravité dans des matières tangibles, les mains apposées aux murs, Franz s’efforcera jusqu’au bout de garder un ancrage avec le réel. La nature, en bande sonore, se superposera avec force au lugubre du crépi et du béton.
Les éléments tendront à résonner les uns pour les autres. Alertes, nous assimilerons le son d’un moulin qui brasse son blé à celui d’un train qui roule vers la mort. L’eau des torrents, quant à elle, nous libérera de celle déversée sur les sols d’un hangar sinistre.
Sans révéler complètement l’exact enchaînement scénaristique du film, il me faudra finalement énoncer cette scène tardive du film, dans laquelle Franz et Fani, privés du droit de se toucher, nous feront intérieurement hurler de tristesse. La dimension tactile, si forte et assumée dans toute la première partie du film, aura laissé son empreinte sur le spectateur, et cette scène de retrouvailles si injustement représentative de leur couple, ravivera cette empreinte et nous animera d’une indicible douleur.
C’est ainsi qu’on acquiesce, sans le savoir, de toute la démarche cinématographique de Terrence Malick. Du rejet à la fusion, il n’y a qu’un pas, et le spectateur – bien que n’étant jamais tout à fait certain jusqu’à la dernière minute d’avoir participé à cette intimité –, se retrouve lui aussi arraché d’une étreinte, démuni et paralytique.
Février 2020
![]()
Une vie cachée, Terrence Malick, 2019

Une vie cachée, Terrence Malick, 2019
3 Aventures de Brooke
Xingxi, alias Brooke, parcourt la campagne d’Alor Setar lorsque le pneu avant de sa bicyclette crève sur une petite route accidentée. Cette scène est le berceau du film, et de chacune des trois histoires qui vont suivre.
À la manière d’Alain Resnais avec Smoking/No Smoking, Yuan Qing explore les potentialités d’une même situation pour en déployer les suites possibles. À la différence qu’ici, le scénario use de recoupements poético-magiques laissant supposer de l’évolution du personnage de Brooke au fil de ce qui sera finalement une seule et même épopée.
Des singes amateurs de cristaux plus que de bananes, un écrivain en mal d’inspiration, un ruisseau et des larmes empreintes d’une certaine féerie, un vieux quartier qui ne veut pas être rasé, des rizières, un épouvantail, des cartes de tarot, un décor panoramique qui donne le tournis… Ce long-métrage fourmille d’images romanesques et ludiques, embarquant le spectateur en balade, et nous détournant avec Brooke d’un objectif premier : la réparation de son vélo.
C’est comme si le film avançait en deux axes.
L’un, rapidement évident, qui serait l’axe de la répétition et de la comparaison ; dès la seconde aventure, en offrant au spectateur la même scène d’ouverture, la réalisatrice nous informe que ce qu’on vient de voir s’apprête à être rejoué. Nous sommes alors sur le qui-vive. Quelles rencontres fera Brooke cette fois-ci ? Quelles en seront les différences ?
L’autre axe de lecture n’apparaît que plus tardivement, lorsque le spectateur commence à assimiler les données des différentes fables. Il s’agit d’un axe de perception évolutif.
Dans chacune des 3 aventures parallèles sont distillées des perturbations, des informations qui nourrissent à rebours l’histoire précédente. Par la lecture préalable et séparée de chacune de ces histoires, une nouvelle lecture simultanée se tresse.
Si l’on symbolise le premier axe par 3 bâtonnets verticaux parallèles, le second axe serait un trait horizontal traversant les trois autres.
Brooke grandit, et l’ordre des rencontres sur sa route a été minutieusement choisi par Yuan Qing afin de nourrir le personnage et de le faire évoluer d’un point A vers un point B.
Ainsi, même si l’on a la sensation par deux fois d’un retour à la case départ, il n’en est rien car Brooke a mémorisé le chemin parcouru.
Son personnage se révèle au fil des histoires, et traversant des mues, se dépouille de ses anciennes peaux. Les raisons de sa présence à Alor Setar sont progressivement dévoilées, et les mensonges des premiers temps, semblables aux pétales d’une marguerite, sont arrachés et virevoltent pour regagner leur variante initiale.
Ce qu’il y a d’encore plus beau, c’est que ce chemin parcouru n’est pas seulement intrinsèque au personnage et à son histoire, il est aussi plus largement représentatif du pont qu’emprunte la réalisatrice, d’un cinéma de filiation jusqu’à son propre cinéma.
Très habilement, délicatement, à l’image de son personnage, Yuan Qing crée sa propre identité cinématographique ; et tandis que la première aventure nous accueille familièrement dans les images d’un Rohmer, l’évolution des rencontres et des intrigues crée petit à petit une nouvelle singularité, un nouvel espace de représentation. Nous sommes ici et ailleurs, les espaces-temps du cinéma et d’Alor Setar se confondant pour nous rappeler que toute interaction spatiale et temporelle est génératrice de nouvelles matières.
Finalement, nous serons heureux de constater qu’Éric Rohmer est toujours là, d’un bout à l’autre du film, et par une scène nocturne scintillante, Yuan Qing parviendra à créer un magnifique hommage au Rayon vert, tout en opérant un glissement scénaristique. Il faisait jour, il faisait vert ; il fera nuit, il fera bleu.
Février 2020
![]() 3 Aventures de Brooke, Yuan Qing, 2018
3 Aventures de Brooke, Yuan Qing, 2018
 3 Aventures de Brooke, Yuan Qing, 2018
3 Aventures de Brooke, Yuan Qing, 2018Parasite
La famille Kim, la famille Park : deux familles vivant dans une même ville de Corée du Sud ; l’une dans le sous-sol d’un quartier pauvre, l’autre dans une maison d’architecte au sommet d’une colline aisée.
Le schéma familial est le même : un père, une mère, un fils, une fille.
Le fils Kim, Ki-woo, se voit offrir l’opportunité de dispenser des cours d’Anglais à la fille Park, Da-hye. Cette brèche d’apparence anodine sera en réalité le seuil d’un gouffre absorbant, où la détermination d’une famille croisera la crédulité de l’autre, dans une incontrôlable épopée funèbre.
Semblable à une balle de tennis qui rebondit sur les marches d’un grand escalier, et qui par ses rebonds engendre à chaque marche le corollaire du rebond précédent, l’entrée de Ki-woo dans la maison Park est une déflagration sourde. Il est le point d’entrée de la famille Kim dans la vie des Park, et marque le début d’une longue partition.
La maison des Park – lieu de toutes les intrigues – symbolise à elle seule la portée du propos de Bong Joon-ho. Les notions de richesse et de pauvreté sont illustrées par les différents étages de cette maison, en commençant par les sous-sols.
Tout dans ce film sert l’imagerie des classes sociales, du haut et du bas, du dessus et du dessous, du montré et du caché – ce qu’on voit, ce qu’on ne voit pas, ce qu’on sait, ce qu’on ne sait pas. Le mensonge, les apparences, les apparats. Entre naïveté, sagacité et vanité, les portraits des différents protagonistes sont dressés de sorte à susciter une empathie équivoque, et le spectateur chavire d’un camp à l’autre, ne sachant pas toujours à quelle famille s’identifier. Car il y a au cinéma un processus d’identification quasi contraint, qui dans le cas de Parasite peut créer une scission intéressante au sein d’un groupe de spectateurs. Et cette scission, plus complexe que le binaire pauvre/riche, interroge les jeux de rôles qu’incarnent les acteurs d’une société ; les fantasmes, peurs, répugnances et convoitises des êtres.
L’exploit de Bong Joon-ho est le basculement pivot du milieu du film. Le plateau de jeu se retourne pour en découvrir le verso masqué, avec des existences insoupçonnées. Un vertige immense, physique, mental, nous envahit et nous propulse en avant, en chute libre dans le dédale de la grande propriété, telle une eau libérée de son barrage. Cette eau n’est d’ailleurs pas seulement présente de façon métaphorique. Réel facteur de débordement dans le film, elle inonde par les pluies campings et sous-sols, faisant rejaillir les liqueurs noires d’un autre monde.
Le fantastique s’invite presque dans Parasite, et par ce biais, allié au suspense, nous maintient dans une excitation cinématographique qui annihile le potentiel simplement sinistre ou morbide du film.
Il y a également une importante puissance comique dans les dialogues et la vigueur des personnages. L’hilare côtoie le drame, et génère une sorte d’allégresse orchestrée par les ralentis et la musique, cette dernière dégringolant les escaliers sur les talons des personnages, et transformant une formidable scène de bagarre en ballet aérien.
À terme, le fou rire, qui n’est pas exempt de larmes, et qu’on ne saurait qualifier de salvateur ou de malsain, semble être la seule réponse qui résiste face au grand théâtre de la vie humaine.
Janvier 2020
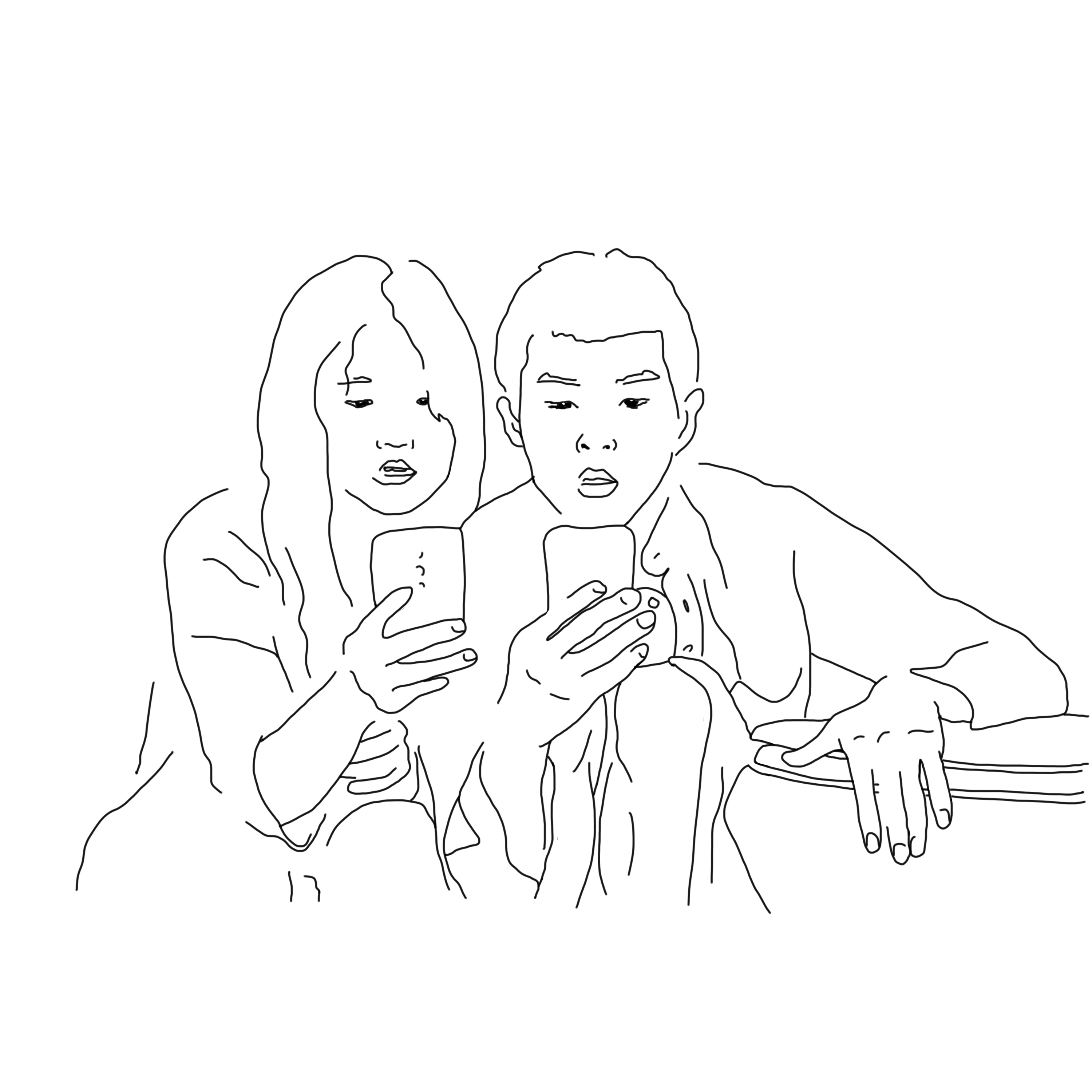
Parasite, Bong Joon-ho, 2019
Notre dame
Valérie Donzelli a toujours su manier l’ingénuité avec beaucoup de poigne. Notre dame ne déroge pas à la règle, et l’on retrouve dans le personnage de Maud Crayon la même candeur effrontée qu’arborait Adèle dans La Reine des pommes.
Maud Crayon, architecte, se découvre simultanément enceinte et lauréate d’un concours auquel elle n’a pas participé. Sa maquette s’est envolée par la fenêtre de chez elle un soir d’orage, et est allée rejoindre les autres candidates dans le dépôt de maquettes du concours de la mairie de Paris, pour l’aménagement du parvis de Notre-Dame – le scénario n’est qu’affaire de hasard avec les événements réels qui ont saisi depuis la cathédrale, renforçant la fantasmagorie autour du monument et du film.
L’envol de cette maquette d’architecture, féerie fantastique insufflée dans la comédie de Valérie Donzelli, n’est que l’une des nombreuses délicieuses étrangetés de la mise en scène. Parmi d’autres nous notons : le port de bottes de pluie mises à disposition par la mairie de Paris, en raison des fortes pluies ; les claques portées aux visages d’inconnus par d’autres inconnus, dans les espaces publics ; une fausse attaque chimique couleur bonbon.
Ces étrangetés invitent la menace et le belliqueux à figurer dans le film, mais par le biais du comique, et permettent d’aborder des questions de société avec verve et gaieté.
Non sans nous rappeler la démarche cinématographique d’Elia Suleiman, Valérie Donzelli nous dépeint à sa manière un Paris burlesque et fiévreux, en proie à tous ses instincts.
Les êtres sont au bord d’une ligne de fracture, à la frontière du règne animal. À cette image, les gifles assénées inopinément dans la rue traduisent à la fois la grande vulnérabilité des giflés, mais aussi l’amertume des gifleurs. Le film bascule d’un point de vue à l’autre, nous rendant spectateurs tantôt d’un acte d’incivilité des plus agressifs, tantôt d’un acte de résistance. Et le point de bascule n’est pas si facile à identifier ; peut-être parce que l’un n’empêche pas l’autre. Gifleur et giflé ne sont finalement que les deux faces d’une même pièce, et la gifle la représentation d’une tension contradictoire contenue dans un seul geste.
Valérie Donzelli jouit de nombreux codes avec une aisance grandissante. Une voix off qui mime la Nouvelle Vague, des dialogues rythmés et caustiques, une scène dansée, une autre chantée, des effets visuels à la Mary Poppins, le tout brassant fragilité et vitalité.
Cette richesse de représentation nourrit le film d’une densité exaltante, fourmillant de détails de jeu et de mise en scène fertiles. Virginie Ledoyen et Bouli Lanners nous offrent ainsi un duo incongru et sensible d’adorables malfaiteurs, jouant du tactile avec une indécence à peine contenue.
En toile de fond se trament les contestations populaires concernant la dimension visuelle phallique du projet d’architecture de Maud. Le chantier est stoppé et le projet doit passer en jugement.
Plus qu’un clin d’œil, Valérie Donzelli nous livre la complexité réactionnaire du peuple, quand ce dernier s’insurge de l’idée d’une œuvre dans le paysage urbain, sans même laisser sa chance à l’artiste de la réaliser.
Nous sommes un peu émus lorsque, citant Daniel Buren au sujet de ses colonnes, le film nous engage sur une réflexion morale vis-à-vis des œuvres et de leur intégrité. Indéniablement l’art s’offre au regard, mais comme le dit très justement Buren, il y a quelque chose de catastrophique et d’intolérable dans l’interruption d’un processus de création, et dans l’intrusion de ce regard prématuré sur une œuvre en cours de réalisation. Une œuvre n’appartient à personne d’autre qu’à son artiste, encore plus lorsqu’elle n’est pas parachevée.
(…) puisque c’est comme si on entrait dans mon atelier et que d’un seul coup on se mettait à critiquer des œuvres non finies, des sculptures en cours de route, et qu’on commençait à les exposer, et qu’on finissait par les juger telles quelles.
Ce travail n’est pas fini, c’est une œuvre en cours de route, et une fois de plus on ne peut pas même en avoir la perception avant qu’elle soit terminée.
Janvier 2020

Notre dame, Valérie Donzelli, 2019
Les Filles du docteur March
J’ai les yeux qui me brûlent lorsque je ferme les paupières. Les images pleines de chaleur du film de Greta Gerwig ont laissé leur empreinte sur ma cornée, et je sens encore la fièvre des feux de cheminée mêlée à celle des larmes.
Meg, Amy, Beth, Jo.
Quatre sœurs à la croisée des chemins, ou comment devenir une femme dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Réadapter des classiques me semble être une manière judicieuse d’aborder des questions transgénérationnelles.
La représentation du passé offre souvent davantage de possibilité romanesque que la représentation du présent – cette dernière étant plus soumise aux contraintes de vraisemblance –, et permet de prendre un certain recul sur une période donnée, tout en rendant manifestes les évolutions humaines et sociétales.
Parler aujourd’hui du féminisme du XIXe siècle est une façon de décupler le courage dont les femmes ont pu faire preuve. Nous pouvons ainsi mettre en relief, un siècle et demi plus tard, leurs pensées et leurs combats.
Cette distance nous aide à porter un regard relatif sur notre ère contemporaine, car non sans savoir que le monde continue chaque jour de créer son lot d’anicroches, force est de constater les facilités qu’a apporté la modernisation de notre quotidien. Et observant les difficultés auxquelles devaient faire face les filles March, on ne peut qu’admirer leur détermination à survivre et à se réaliser, voire envier une forme d’abnégation qui peut se rendre salutaire dans la création, lorsque dans l’urgence et la peur de se voir ôter ce qui nous est de plus cher, on se donne tout entier à une vocation.
Il y avait déjà en 1868 la question de s’affranchir des hommes, mais elle restait corrélée à la question de la survie et de la famille, du soutien à cette dernière, et du partage des ressources gagnées.
Cette notion de famille – de laquelle nous essayons parfois de nous arracher aujourd’hui – est le socle du combat des March, et leurs liens indéfectibles sont la condition de leur force.
On est touchés par cette sororité, qui plus est entre sœurs de sang, bien que ces liens n’excluent pas querelles ni jalousies. Leurs personnalités si complémentaires, muées par des disciplines artistiques différentes, s’électrisent en traversant l’adolescence. Leurs amères frustrations rencontrent ainsi leurs plus grandes peines, mais l’amour règne au sein de leur maison, laquelle reste le vivier de leurs échanges et le lieu de gestation de leurs désirs.
Entre orgueil et impétuosité, à travers les portraits d’Amy et de Jo se dessine aussi la grande difficulté, voire l’impossibilité d’accepter la médiocrité. L’intransigeance sévit dans leur travail créatif. Elles veulent être des génies, sinon rien. Cette ambition affirmée dans le cocon de leur salon n’est pas sans dégager une certaine tristesse lorsqu’elle butte ensuite sur les sempiternels obstacles liés aux mœurs ou à l’argent.
Les choix de réalisation de Greta Gerwig servent l’acquisition émotionnelle du spectateur. Construit sur deux temporalités qui s’entremêlent, le film invoque les souvenirs de Jo et les met en miroir de son présent, pour mieux en comparer les pertes, les retrouvailles et les manques. Certains suspenses se croisent ainsi dans la frise du temps, pour n’en révéler que tardivement les issues, contrairement à la construction chronologique des romans de Louisa May Alcott.
Le film est ceint de cette double-scène chez un éditeur, où Jo tient tête à un homme qui la méprise et tente de l’escroquer. Mais ce qui nous marque au-delà est la ténacité de Jo, et l’intuition qu’elle a de sa légitimité. Elle ne lâchera rien avant de parvenir à ses fins, n’hésitant pas à répéter ses assauts. On savourera la beauté de l’accomplissement, toutes les étapes durant lesquelles on pourra observer la confection d’un livre, jusqu’aux dorures de la couverture.
Certains critiqueront la joliesse de ce film, qui par tous ses aspects aura tendance à adoucir chacune des épreuves que rencontrent les héroïnes. Mais cette douceur n’amoindrit pas les émois, et autorise au contraire l’émotion à s’émanciper de la position pudique du spectateur. On se laisse aller à l’engourdissement lacrymal, sans rébellion. Et l’on ne saurait reprocher à Greta Gerwig de nous offrir à la fois la ferveur implacable de Jo, et la tiédeur réconfortante de Meg.
Il n’est en somme pas d’adaptation plus humaniste qu’une représentation qui intègre chacune de ces quatre héroïnes avec tant de mansuétude et de générosité.
Janvier 2020

Les Filles du docteur March, Greta Gerwig, 2019
Marriage Story
A l’instar d’un autre de ses long-métrages, Les Berkman se séparent, le dernier film de Noah Baumbach parle également de séparation. Mais le choix du titre, Marriage Story, n’est pas anodin, tant il est davantage question d’amour que de rupture.
Le mot divorce a ceci de très cruel qu’il crée une rupture autant physique que langagière dans l’union des êtres aimés. Comme si, une fois prononcé, le divorce annulait l’histoire de son mariage. Il est pourtant essentiel de conserver l’idée qu’un divorce ne peut exister sans mariage, et que nombre d’entre eux ont impliqué de l’amour.
C’est le cas de Nicole et Charlie, sur le point de divorcer, qui s’aiment pourtant d’un amour sincère, profond et bienveillant.
Comment concilier amour et choix de carrière ? C’est la question que se pose Nicole, et que pose le film.
Elle a quitté Los Angeles il y a plusieurs années pour suivre Charlie à New York. Leur union, publique et privée, l’a rendue heureuse un temps, l’illusionnant d’un épanouissement professionnel. Ils ont eu un enfant, et petit à petit l’évidence a resurgi. Comme une tache dont on craint de voir réapparaître les contours au séchage, après avoir trempé et frotté le tissu. La vocation initiale de Nicole s’est réveillée. Pour elle, New York n’avait qu’un temps, et le couple a feint de ne pas le voir ni de l’entendre ; en mode sourdine.
Ce qu’il y a d’horrible dans leur divorce est tout l’autour, ce qui est externe à leur couple : la collègue de travail qui recommande la meilleure avocate du coin, ou la relation extraconjugale qui espère pouvoir rapidement sortir de l’ombre.
Ils sont précipités dans la procédure de divorce, tels des gladiateurs inexpérimentés envoyés dans une arène, où l’on hurle et l’on crache, sur tout mais surtout sur leur histoire.
Ils ont beau affirmer que tout se passera bien, qu’ils se font confiance, ils se retrouvent en permanence avertis des inévitables drames qu’ils seront obligés de vivre, en tant que futurs ex-mariés nécessairement haineux.
Pas de parti pris dans le film, sinon celui de pointer du doigt ceux qui doivent défendre un camp : les avocats. Ces derniers s’approprient l’histoire de leurs clients, comme une de plus, avec un nivellement par le pire.
Il existe et persiste néanmoins un problème bien réel. Charlie souhaite vivre à New York, Nicole à Los Angeles ; compromis impossible puisque la garde d’un enfant est en jeu. Henry, fruit non cessible de l’amour, catalyseur des tensions, se retrouve au cœur des négociations.
Le niveau de l’eau monte, et cette dernière est frémissante. Ils n’échapperont pas à la dispute qu’ils s’étaient juré de ne pas avoir. Jouant le jeu de la surenchère verbale, ils atteindront le point de non-retour. Éreinté, Charlie capitulera à genoux. Et Nicole, en guise d’assaut final, d’une caresse sur le dos essuiera toute la vilenie de leurs échanges.
Car la tendresse persiste tout le long de leur séparation et au-delà, comme une respiration, la ponctuation du film.
La scène la plus mémorable est peut-être cette scène de bar, au terme du jugement, lorsque de retour temporairement à New York, Charlie s’empare du micro pour entonner une chanson de Broadway.
Il y a une telle force d’authenticité dans cette scène, un hymne à la vie désarmant. Charlie sort écharpé de cette aventure. Il est à nu, il n’a plus rien, plus d’artifice ni revendication. Mais il est en vie.
Someone to hold you too close / Someone to hurt you too deep / Someone to sit in your chair / And ruin your sleep / And make you aware of being alive
Someone to need you too much / Someone to know you too well / Someone to pull you up short / And put you through hell / And give you support for being alive, being alive / Make me alive, make me confused / Mock me with praise, let me be used / Vary my days, but alone is alone, not alive!
Somebody hold me too close / Somebody force me to care / Somebody make me come through / I’ll always be there / As frightened as you of being alive / Being alive, being alive!
Décembre 2019

Marriage Story, Noah Baumbach, 2019
La Reine des neiges II
Elsa, reine d’Arendelle récemment couronnée, détient des pouvoirs glacés dont l’origine lui est inconnue.
Un beau jour, elle entend une voix chantante l’appeler par-delà les montagnes de la vallée.
Il y a quelque chose de grave et d’adulte dans ce film d’animation aux apparences princesse et paillettes. Notre reine n’est pas sereine, et son visage soucieux gangrène sa beauté.
Enrobée d’une histoire fourmillant de détails liés à la nature et à la magie, La reine des neiges parle en réalité de cette quête très sérieuse qu’est la psychanalyse, lorsqu’enfoui en nous quelque chose nous appelle et nous incite à partir en quête d’une vérité passée. Cela se traduit dans le scénario par une aventure physique, au sein d’une forêt enchantée et d’une mer tempétueuse, mais ce n’est que pour mieux affirmer la métaphore d’une investigation introspective dense et conflictuelle. La paix du royaume d’Arendelle n’est qu’un prétexte pour Elsa à rechercher l’apaisement intérieur ; et la crainte de l’inconnu, cette voix douce-inquiétante qui l’appelle, est la juste mélodie du passé qui tiraille les adultes parfois traversés d’un malaise diffus prenant sa source dans un inconscient mouvant et instable.
Elsa est prisonnière de cette mélodie, qu’elle est la seule à entendre, et qui détient la vérité sur le passé de son royaume et des peuples qui jadis se sont entretués.
Le film est jalonné de chansons, dont l’équilibre est assuré par la diversité des intrigues et des personnages. Nous sommes ainsi balladés de la berceuse à la complainte amoureuse, en passant par les vocalises et cabrioles drolatiques du personnage d’Olaf, petit bonhomme de neige animé par les pouvoirs d’Elsa.
Et sont disséminées ici et là des paroles marquées par cette quête de la connaissance de soi.
Au tout début, la berceuse parle de la source de la vérité, une source-rivière. Quand le vent frais / Vient danser / La rivière chante / Pour ne pas oublier / Ferme les yeux / Si tu veux voir / Ton reflet / Dans ce grand miroir.
Vient ensuite la chanson-étape de résistance. Oui je t’entends, mais c’est non / Parce que tu n’es pas la solution / J’aurais mille raisons / De vivre comme il me plaît / D’ignorer tes murmures / Faire comme si de rien n’était.
Au point de rencontre de la voix et d’Elsa, après avoir bravé la mer à dos de cheval glacé, figure enfin la résilience. Je te cherche, j’ai fini de trembler / Me voilà, je veux savoir / Tu es la réponse que j’attendais, que j’espérais.
L’émotion est là, dans le tourbillon des images de glace qui émergent autour d’Elsa. Elle réalise le rôle qu’elle a à jouer entre les différents éléments ; tout s’imbrique et se transforme dans une jubilatoire révélation du point névralgique de sa quête.
Mais dans la grotte magnifique se dérobe un sol qui révèle d’autres strates plus noires du passé. L’avertissement de la berceuse qui résonnait aux oreilles d’Elsa tout du long – Si tu plonges dans le passé / Prends garde de ne pas t’y noyer –, se matérialise lorsqu’à pic d’une falaise, elle plonge littéralement, pour le meilleur et pour le pire, dans les tréfonds de glace d’une mémoire collective censée délivrer son royaume.
Résistance, résilience, délivrance ? Le chemin n’est pas sans périls, et à chaque pas dans le vide auquel se risque Elsa, sa sœur Anna lui rappelle combien il importe, certes, de se sentir en vie, mais surtout de rester vivant.
Décembre 2019
![]()

La Reine des neiges II, Jennifer Lee, Chris Buck, 2019
Toni Erdmann
Je peine à exprimer l’indicible de Toni Erdmann, par peur des mots faciles, des mots traîtres, ceux qui ne seraient pas à la hauteur de l’émotion contenue du film, et du temps que Maren Ade prend pour la déployer.
Nous sommes en présence de trois protagonistes, dont le troisième est une entité mouvante et commune aux deux autres. L’entité, c’est Toni Erdmann, en tout premier lieu le double ubuesque de Winfried Conradi, petit à petit assimilé par sa fille Ines. Winfried se sert de Toni pour essayer de venir en aide à cette dernière, consultante expatriée dont la vie n’est régie que par des préoccupations d’ordre professionnel. Il usera pour cela de différents outils : lunettes de soleil, menottes, râpe à fromage, perruque… Mais l’accessoire ultime est ce faux dentier grotesque, qui en toute circonstance reste accessible dans la petite poche de sa chemise, contre sa poitrine, tout près de son cœur – lequel est soumis à surveillance par une ceinture cardiaque, élément non maîtrisé du déguisement.
Il y a beaucoup d’amour englouti entre ce père et sa fille, qui ne parviennent pas à communiquer.
L’humour de Winfried – revêtir la cape de Toni Erdmann – est une façon d’échanger avec Ines, de redevenir son père par le biais d’un autre rôle que celui qu’elle a rejeté. Il devient un anti-héros gênant, encombrant et pathétique, qui tente de la sauver de l’aliénation du travail.
Cette folle audace de vouloir dérider sa fille en refusant de se plier à la bienséance guindée qu’elle lui réclame pourrait ne faire qu’empirer la situation, et c’est tout d’abord le cas ; mais subrepticement, on commence à lire dans l’expression figée d’Ines une réinterrogation de la vie, l’émergence d’un nouvel existentialisme. Leurs jeux de rôles seront une manière de jouer « à travailler », afin de porter en ridicule toute une organisation sociale, finalement plus absurde que l’absurdité des rôles qu’ils se donnent.
L’émotion est à son comble lorsque chacun pousse à l’extrême et dans un sens opposé l’un de l’autre, le burlesque du déguisement. Tandis qu’Ines se met à nu, Winfried revêt le costume d’un kukeri. Cette opposition visuelle porte en réalité le même message de transcendance et de vérité, et leur permet de se rejoindre un instant dans un élan d’amour sans filtre. Mais cette étreinte ne donne pas le point final au récit, car le film, à l’image d’une grande solitude, dans le don ne trouve que rarement une main à saisir.
Dans la décennie, Toni Erdmann étincelle comme une étoile longue durée. Maren Ade a relevé le pari d’un réalisme austère débordant d’archimagie.
Décembre 2019

Toni Erdmann, Maren Ade, 2016
It must be heaven
En sortant du cinéma je ne peux m’empêcher de relever le ballet mécanique qu’opèrent les usagers de nos espaces publics. Bancs, trottoirs, routes, tunnels, escaliers ; avec leurs simples pieds ou leurs vélos, planches à roulettes, trottinettes.
J’ai l’œil aiguisé par Elia Suleiman, lequel j’ai observé observer nos danses, de la Palestine aux Etats-Unis, en passant par la France.
La position du spectateur est très intéressante car nous sommes à la fois celui qu’Elia Suleiman contemple, mais également le regardeur. Par des champs-contrechamps incessants la caméra passe d’Elia aux tableaux burlesques qu’il observe, et nous sommes ainsi en rebond et par miroir, tout à la fois face à lui, ce qu’il contemple, mais aussi lui-même – ou transposé à ses côtés, un observateur.
« Regardons-nous nous-même », cela pourrait-il vouloir dire. Et Suleiman de nous indiquer par hochements de tête directionnels quelles parties du tableau observer.
Qu’y a-t-il à voir ?
Contempler la ronde de nos policiers, qui tantôt affublés de planches gyroscopiques, de jumelles, de mètres rubans ou d’une couverture, tournent en rond et se transforment en clowns accessoirisés ; une accessoirisation parfois minimale mais non moins outrancière – paradoxe qui leur donne une pleine puissance humoristique, et par le ridicule annule leur puissance terrifiante.
Les scènes sont comme extraites d’un réel en mouvement dont on a mis l’affluence autour sur stop. Nous sommes concentrés sur un sujet, et le calme règne dans une grande agitation supposée. Cela permet de rendre visible l’invisible, et de s’y attarder.
Le silence d’Elia Suleiman est comme une invitation à regarder la vie sans répondre, une invitation à feindre l’ignorance et l’intérêt tous azimuts.
C’est le rôle de l’ingénu qu’il questionne à travers cette posture du silencieux. Le silencieux qui ne baisse pas les yeux, qui interroge, qui est curieux. Quoi de plus essentiel que de rester observateur et curieux ?
Tout le sens de ce mutisme est appuyé par les exceptionnelles paroles prononcées à bord d’un taxi new-yorkais. Il est un Palestinien de Nazareth.
La surprise est alors entière, à la fois d’entendre le son de sa voix, mais également de l’entendre énoncer cette vérité folle. Il est un Israélien palestinien. Et il ne parlera que pour affirmer sa vérité fondamentale et intime, qui fait corps pour nous dans le film en tant que seule parole émise.
Quelle meilleure autre façon de faire passer un message que de le rendre unique ?
Une voix, un son, une parole.
Décembre 2019
![]() It Must Be Heaven, Elia Suleiman, 2019
It Must Be Heaven, Elia Suleiman, 2019
 It Must Be Heaven, Elia Suleiman, 2019
It Must Be Heaven, Elia Suleiman, 2019Porco Rosso
La magie de Porco Rosso réside dans sa faculté de désamorcer l’attendu.
J’avais vu pour la première fois ce film d’animation il y a quelques années, et j’ai été surprise de constater en le revoyant aujourd’hui que mon esprit avait peint et projeté sur le film de nouvelles images mentales ; notamment une fin différente, fortement fantasmée.
Je pensais retrouver des explications plus claires à ce visage de cochon, et j’étais convaincue de voir Porco redevenir Marco, dans les bras de Gina, sans équivoque.
Mais toute la grande subtilité du film tient en l’association de différentes scènes qui dans notre cerveau crée un mélange aux multiples possibilités. On est libre de réagencer à notre guise, et ce visage d’un Marco jeune peut alors être transposé où bon nous semble sur celui du cochon ; et particulièrement à la fin lorsque dans le regard de Curtis naît cette vision. Nous ne voyons pas mais nous visionnons, et ces perceptions sont encore plus fortes car forgées en nous-mêmes.
Ainsi j’étais persuadée de me souvenir de Porco au milieu de l’île verdoyante de l’hôtel Adriano, tandis que comme le souligne précisément Gina au milieu du film, c’est bien Curtis qui s’y rend alors qu’elle en attend un autre ; et cette fin au fort goût d’éclipse nous laisse rêver à loisir de voir Marco apparaître et poser son hydravion alentour.
Tout est doux dans Porco Rosso. Le piano d’Hisaishi, les couleurs du printemps se reflétant dans l’Adriatique et dans les lèvres glossées de Gina, la fumée blanche de la cigarette de Porco et celle de son engin rouge qui effectue des pirouettes dans les différentes couches du ciel.
Porco l’aguerri, ayant fui la guerre, marqué par on ne sait trop quel sort, probablement celui d’avoir osé défier l’ordre armé établi, pour être un homme de l’eau et de l’air, sans joute funeste.
Novembre 2019
![]()

Porco Rosso, Hayao Miyazaki, 1992
Phantom Thread
Hésitante, je regarde autour de moi le hall vide. Je ne vole l’attente de personne devant la borne d’achat et peux donc prendre un peu de temps, un peu de mon temps. Mais vite tout de même, car les publicités viennent probablement de commencer.
Il est 22 heures et j’ai pénétré dans ce grand cinéma du centre-ville pour échapper au froid. Les pensées affleurent et se contredisent. Un quart d’heure à tuer avant mon prochain bus. Aller voir un film ?
L’idée commence à fleurir de ne pas rentrer tout de suite chez moi.
L’excitation de prendre une décision rapidement, spontanée, et seule.
Phantom Thread. Je ne sais pas ce dont il s’agit, je n’ai pas d’a priori positif mais ce film me procure une idée de dépaysement, et c’est ce dont j’ai besoin au cinéma depuis quelque temps : me sentir dépaysée, être étonnée, emmenée ailleurs, loin des images nombrilistes que je cultive depuis l’adolescence avec certains films français ; et une grande lassitude en revers, ma cinéphilie qui a faim d’autre chose...
Je décide d’utiliser comme un joker la place cartonnée prépayée dont on m’a fait cadeau.
Le film est projeté dans la plus petite salle du cinéma, probablement réservée aux films un peu moins grand public, pour une séance tardive du samedi soir.
Je m’assieds en retrait sur un côté, à l’aplomb des sièges presque vides.
La batterie de mon portable est à plat mais je suis sereine. J’ai prévenu Xavier que je ne rentrerais pas avant minuit.
Le film commence.
Une douce enveloppe de grâce m’emporte dans les tissus, les sons, la musique, les regards, gestes et sourires – tantôt tendres, espiègles, cruels ou naïfs.
Je suis si heureuse d’être touchée par des personnages auxquels je ne m’identifie pas nécessairement, mais qui par leur force et leurs jeux – mais aussi le jeu des acteurs –, me convainquent de sortir de mon ego, de mon centre à moi. Car n’est-ce pas finalement ce que l’on attend du Cinéma ? Être emporté quelque part, dans un ailleurs sensible si puissant qu’il nous déconnecte de nous-même pour nous intégrer à la beauté d’un autre mouvement, d’une autre vie, de la vie d’un ou plusieurs personnages touchés par la grâce, et la grâce de l’interprétation de leurs acteurs (Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps).
On se délecte d’un travail sonore si précis, incisif et juste, à l’image d’une grande paire de ciseaux métallique dans de la soie.
La bande originale nous donne la cadence, rythme les pas de Reynolds Woodcock dans les escaliers de sa demeure. On retient notre respiration avec les employées de la maison quand le maître couturier entre dans une pièce.
La musique accentue aussi les battements de nos cœurs et les accorde avec ceux d’Alma et Reynolds.
On partage la noble exigence de ce grand couturier esthète, dans son travail comme avec ses semblables ; on la rejette néanmoins lorsqu’elle devient mortifère.
On se joue de lui avec Alma, et on a le cœur pincé avec elle lorsqu’il se montre dur et brutal.
Car il fait souvent preuve d’une sévérité si froide, à la croisée du granit et du marbre.
A contrario pourtant il sait se montrer d’une si douce finesse, ensorcelé par Alma, qui s’avère plus manipulatrice que manipulée.
Et comme la glace fond au soleil, Reynolds se révèle une pierre friable.
Leurs jeux deviennent un langage codé pour se comprendre et s’apprivoiser, se tolérer et se donner l’un à l’autre, et enfin lui à elle, dans un élan de dépossession et d’abandon.
Je sors du film libre et légère, animée d’une force créative rare.
Minuit passé, le centre ville désert, les bus ne circulent plus.
J’emprunte un vélo et rentre en longeant les quais. J’ai les mains gelées mais la chaleur aux lèvres.
Il n’y a pas plus bel espoir lorsqu’on a peur de perdre sa cinéphilie que de démarrer l’année avec Phantom Thread.
Malgré cela, presque un an après, il n’a pas été détrôné par un autre chef d’œuvre et il est, tout comme Toni Erdmann l’année précédente, l’unique film qui m’a hantée cette année – mais quel fantôme !
Décembre 2018
![]() Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, 2017
Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, 2017
 Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, 2017
Phantom Thread, Paul Thomas Anderson, 2017